Découvert hors compétition à Annecy, Happiness road est le premier long métrage de la réalisatrice taïwanaise Hsin-Yin Sung. A la fois joyeux et profond, mélancolique et drôle, il s'adresse plus particulièrement à un public d'adultes ou de jeunes adultes, ce qui n'est malheureusement pas si fréquent dans le monde de l'animation.
Son héroïne est en effet une jeune femme qui vit aux Etats-Unis et revient à Taïwan, son pays natal, à l'occasion du décès de sa grand-mère. Ce retour aux sources génère à la fois de nombreux souvenirs issus de son enfance et de son adolescence, mais aussi des interrogations sur ce qu'est sa vie, et ce qu'elle souhaite désormais en faire.
Si le film est plein de nuances et de détails qui le rendent intrigant et précieux, trois raisons principales en font une des sorties incontournables de l'été :
Une vision sans fard de la famille
Dans sa lecture la plus évidente, Happiness road est avant tout une histoire de famille, qui s’intéresse aux liens plus ou moins forts en fonction des époques qui nous unissent à nos parents. Parfois tendre, parfois cruel, le film montre comme les parents apparaissent tour à tour comme des héros ou des embarras, des personnes dépassées que l’on ne veut plus écouter ou au contraire des soutiens indispensables. Bien que la narration ne soit pas linéaire, on reconstitue l’évolution des sentiments de Tchi pour ses parents, et le mouvement de balancier qui la ramène finalement vers eux. À cela s’ajoutent le personnage haut en couleur de la grand mère facétieuse et complice, la « petite bande » de la jeune fille qui lui sert de « famille choisie », les enfants de sa meilleure amie Betty... La réalisatrice observe avec finesse l’immense malléabilité de ces rapports humains toujours en mouvement.
Une fable introspective
La partie la plus intéressante du film, et probablement la plus ambitieuse, est la dimension introspective de l’histoire. Le jeu des temporalités et des correspondances ramène sans cesse le personnage à s’interroger sur sa vie, ce qu’elle en fait, ce qu’elle en attend, ce qu’elle veut changer... À tous les âges, Chi rêve d’un avenir meilleur. Mais c’est dans l’époque contemporaine que ses interrogations prennent le plus d’acuité. À un peu plus de quarante ans, elle est à nouveau à la croisée des chemins, indécise sur la direction qu’elle devrait prendre, comme elle semble l’avoir été une partie de sa vie. La manière dont le film se refuse d'asséner des réponses ajoute à la mélancolie entêtante de cette plongée intime qui éveille forcément des échos chez le spectateur, quel que soit son parcours.
Quarante ans d’histoire taïwanaise
Happiness road se déroule sur une vaste période de temps, entre la prime jeunesse de l’héroïne au début des années 80 et la période contemporaine. Le récit intime est donc étroitement lié à l’histoire sociale et politique de Taiwan, et notamment à son ouverture progressive au monde après la mort de Tchang Kai Chek en 1975. Même si cela n’est jamais souligné, on reconnaît dans le film des temps forts de la démocratisation du pays comme les premières élections en 1996. On assiste aussi à plusieurs vagues de manifestations réclamant la démocratie et la fin de la loi martiale. Le personnage du cousin Weng (poursuivi pour avoir lu un livre interdit) permet également d’aborder la question de la censure et de la répression politique. Enfin, le rêve américain de l’héroïne (qui fait pendant à celui de sa copine Betty, dont le père est un soldat américain qu'elle n'a jamais connu) interroge à sa manière le rapport des Taïwanais à leur île et la voie empruntée par chacun pour trouver à la fois la liberté et le bonheur.





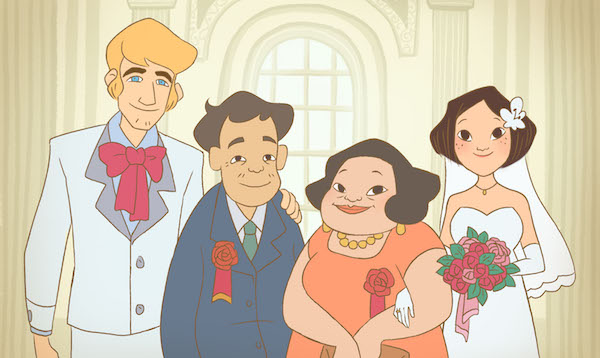

















 Flux rss
Flux rss

