 |
| 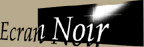 |
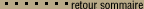 | |
 |
 |
Production : Jean-François Lepetit, Flach Film, CB Films, avec la participation de Canal+ et du CNC
Réalisation : Catherine Breillat
Scénario : Catherine Breilat, d’après son livre Pornocratie
Photographie : Yorgos Arvanitis, Guillaume Schiffman, Miguel Malheiros & Susana Gomes
Son : Carlos Pinto & Filipe Gonçalves
Musique : D’julz
Montage : Pascale Chavance & Frédéric Barbe
Durée : 77 min
Casting :
Amira Casar (la fille)
Rocco Siffredi (l’homme)
|
| | 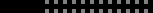 |
|
 |
|
|
|
|
       |
|
 |
Anatomie de l'enfer
France / 2004 / Sortie France le 28 janvier 2004
|   |
 | 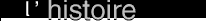 |  |
Une belle jeune fille est seule dans une boîte de nuit. Autour d’elle, des hommes s’embrassent. Dans les toilettes, elle s’ouvre les veines. Un homme, qu’elle a croisé sur son chemin, la sauve et l’emmène dans une pharmacie. Elle lui propose un marché : la regarder par là où elle n’est pas regardable. Pendant quatre nuits, cet homme que les femmes rebutent, viendra la retrouver dans une maison isolée au bord de la mer. Elle le paiera.
|
|
| | |
 |
 |
Anatomie de l’enfer est le onzième film de Catherine Breillat d’après Pornocratie, son douzième roman. Auparavant, la cinéaste s’est illustrée par plusieurs films dont les sorties ont toujours été remarquées et extrêmement controversées (entre autres : Une vraie jeune fille en 1975, 36 Fillette en 1987 avec Etienne Chicot et Jean-Pierre Léaud, Sale comme un ange en 1991 avec Claude Brasseur et Lio, Romance en 1999 avec Caroline Ducey et François Berléand, Sex is comedy avec Anne Parillaud et Grégoire Colin en 2002). Parallèlement, la cinéaste s’est également attachée à l’écriture : outre ses romans qui ont souvent été la base de ses scénarios, elle a écrit pour d’autres réalisateurs. C’est ainsi qu’on lui doit quelques scénarios dont ceux de Police de Maurice Pialat, de E la Nave Va de Federico Fellini (co-écrit par le réalisateur), de Zanzibar de Christine Pascal (idem) et de Selon Mathieu de Xavier Beauvois (idem).
Catherine Breillat fait figure de personnalité engagée. Outre ses films polémiques autour de la féminité, de la sexualité et des rapports entre les hommes et les femmes, elle s’est souvent affichée dans plusieurs combats. C’est ainsi qu’elle a ardemment défendu le film Baise moi de Virginie Despentes contre la censure en 1999.< br>
Cette année, deux livres lui sont consacrés (Catherine Breillat, un cinéma du rite et de la transgression de David Vassé par Arte Editions et Catherine Breillat, indécence et pureté de Claire Couzot dans la Collection Auteurs des Cahiers du Cinéma).
Pour incarner la femme d’Anatomie de l’enfer, Catherine Breillat a fait appel à Amira Casar qui rompt ainsi avec ses précédents rôles grand public (La Vérité si je mens 1 & 2 de Thomas Gilou, Pourquoi pas moi de Stéphane Giusti, Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty). Pour ce rôle surprenant et difficile, la comédienne, qui reconnaît être touchée par l’univers de la cinéaste, s’est inspirée de sa formation classique et de plusieurs grands textes, notamment La Maladie de la mort de Marguerite Duras. Lors de certaines scènes, elle s’est fait remplacée par une doublure et a tenu à ce que ce soit précisé à l’ouverture du film.
Quant au personnage de l’homme, s’est à Rocco Siffredi que Catherine Breillat a confié l’interprétation. La cinéaste souhaitait depuis longtemps lui écrire un premier rôle. Cet illustre acteur et producteur de l’industrie des films X et couverts de multiples distinctions dans le domaine, apparaît pour la seconde fois dans l’univers de la réalisatrice. Auparavant, il avait en effet tenu un rôle secondaire dans Romance, ce qui avait alors revêtu le film d’une dimension très sulfureuse. Le comédien avoue qu’il a trouvé très intéressant d’interpréter des personnages différents, même si ces derniers ont encore un lien avec la pornographie. Il confesse également avoir envie d’aller plus loin et d’incarner des rôles cette fois totalement étranger à son passé cinématographique.
|
|

|
 |
BREILLAT OU LES QUATRE NUITS DE CASAR
"- Il faut regarder quand je ne me vois pas."
"Pornocratie" était un livre cru et son adaptation à l’écran n’est pas en reste. Anatomie de l’enfer désarçonne. Catherine Breillat poursuit son interrogation de la féminité et des rapports entre les deux sexes. Comme toujours, elle frappe fort quitte à choquer. Si ses précédents films avaient gardé une certaine dimension fictionnelle (des personnages identifiables socialement et des histoires palpables), Anatomie de l’enfer en est dénué. Ici, nous sommes dans l’épure. Le dernier film de Catherine Breillat touche au mythe. Une femme. Un homme. Et toutes leurs différences, leurs incompréhensions. L’essentiel est là : qu’est-ce qui fait qu’une femme est une femme ? Quelle est cette féminité qui rebute et effraie autant qu’elle captive ? Dans son dernier film (et c’est, selon la réalisatrice, son dernier film sur ce sujet ô combien difficile et polémique), Catherine Breillat met donc en scène, dans un huis-clos au décor quasi abstrait (une maison presque vide au bout de nulle part), une femme qui, pour certainement mieux se comprendre, s’offre au regard impitoyable d’un homme qui ne l’aime pas. Pire : un homme que les femmes dégoûtent. C’est alors devant ses yeux-là que la féminité va se dévoiler. Ou plutôt : c’est à ce regard que la féminité va se confronter. Le parangon de l’homosexuel semble presque intervenir comme une caricature d’une masculinité finalement très encombrée par la femme. Car dans les films de Breillat, les hommes sont souvent mal à l’aise devant cette féminité si trouble, si complexe et si incomprise. C’est ainsi que, comme dans Romance où Paul refusait de toucher Marie, lďhomme accepte, contre de lďargent, de regarder une femme dans toute sa nudité et son intimité, mais il ne la touchera pas. Du moins dans un premier temps. Car le paradoxe si cher à Breillat va faire son ¤uvre : le dégoût et l’appréhension ne sauraient fonctionner sans leurs contraires inéluctables, à savoir l’attirance et la fascination. Et c’est là que les hommes et les femmes de l’univers de la cinéaste se rejoignent. Tous sont en proie à une fascination que d’aucuns pourront qualifier de malsaine. Il y a quelque chose qui relève de la pureté, de la catharsis chez Breillat. La réalisatrice se montre une orfèvre pour ce qui est de dépeindre ce mystère : parvenir à la pureté, la vérité et la connaissance de soi par le trivial et l’obscène.
Tout se passe toujours entre le sacré et e profane. L’univers de Pasolini n’est pas loin. Catherine Breillat ne lésine pas et s’arrête sur des points qui ne peuvent qu’interpeller : les règles qui sont perçues comme impures et qui rendent la femme elle-même impure, la jouissance féminine et sa dimension psychologique╔ En appréhendant ces sujets de manière très frontale, la cinéaste nous invite à aller au delà de ce qui est montré et à ne pas céder au réflexe instinctif de dégoût. Parce qu’en s’attaquant à l’irreprésentable et à l’indicible, la cinéaste nous demande de nous interroger plus avant sur la signification afin de faire voler en éclat des perceptions généralement partagées en soulignant leur ineptie.
Bien entendu, le film peut parfois paraître aride, notamment au début où la cinéaste utilise une mise en scène analytique et désincarnée. Mais Anatomie de l’enfer prend rapidement tout son sens et la fascination opère. Catherine Breillat signe là une sorte d’aboutissement de son ¤uvre et y concentre l’essence de son propos et des thèmes abordés dans ses précédents films.
Pour finir, un mot sur Amira Casar qui a accepté de se mettre en danger avec un rôle très difficile et qui nous montre la profondeur d’un talent que l’on soupçonnait jusqu’alors.
|
|
 | |
| |
|