 |
| 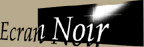 |
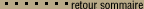 | |
 |
 |
Production: Mark Gordon Prod. / Centropolis Ent.
Réalisation: Roland Emerich
Scénario: Roland Emerich & Jeffrey Nachmanoff
Montage: David Brenner
Photo: Ueli Steiger, ASC
Décors : Barry Chusid
Costumes : Renee April
SFX : Karen E. Goulekas – ILM – Digital Domain
Son : William Sarokin
Musique : Harald Kloser
Durée : 2h00
Casting :
Dennis Quaid: Jack Hall
Sam Hall: Jake Gyllenhaal
Ian Holm: Terry Rapson
Emmy Rossum: Laura
Sela Ward: Dr Lucy Hall
Dash Mihok: Jason
|
| | 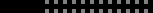 |
|
 |
|
|
|
|
       |
|
 |
The day after tomorrow (Le jour d'après)
USA / 2004 / Sortie France le 26 mai 2004
|   |
 | 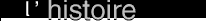 |  |
La communauté scientifique se fait du mouron tandis que la banquise se fendille, signe qu’un bouleversement climatique est proche. Les autorités cupides resteront sourdes aux suppliques des chercheurs jusqu’à ce que les éléments naturels finissent par se déchaîner et semer une pagaille monstre sur l’ensemble des continents. Le visage de l’Amérique se verra transformé du jour au lendemain. Le professeur Hall devra se frayer un chemin dans une ville de New York à demi engloutie sous la glace pour espérer retrouver son fils Sam.
|
|
| | |
 |
 |
Tournage:
L’action de The day after tomorrow se déroulant sur un grand nombre de points géographiques, l’équipe se déplaça dans un premier temps à travers les Etats-Unis pour filmer les extérieurs américains. L’ensemble des séquences prenant place hors des frontières fut en revanche tourné en studio à Montréal, tout comme l’essentiel des scènes d’intérieur. Soufflerie, baignade tout habillé en bassins chauffés, chaque cataclysme à recréer représentait pour l’équipe technique un challenge d’ingéniosité et pour le casting une épreuve physique. Emmerich eut cependant recourt un peu plus à la science numérique qu’à son habitude pour mettre en place certains bouleversements de grande ampleur. Les deux mastodontes de la spécialité, ILM et Digital Domain furent mandatés pour prendre en charge la besogne. On notera au rayon innovation une scannérisation de véritables quartiers de Los Angeles et de New York, permettant de produire des destructions immobilières peu coûteuses et entièrement interactives. Il n’empêche que la facture s’élève au total à 125 M de $, l’essentiel du budget ayant été investi dans les effets spéciaux, véritables stars du film, aux caprices semblables à celles de chair et d’os, puisque la sortie du film initialement prévue pour l’été 2003 fut repoussée à l’année suivante afin de laisser aux infographistes le temps d’exprimer la pleine mesure de leur talent.
Victimes :
L’argent investi soigneusement dans la facture visuelle du film, le casting ne pouvait intégrer de gros cachets. Pas étonnant qu’on retrouve en tête d’affiche le providentiel Dennis Quaid, belle gueule idéale du cinéma américain qui n’est jamais parvenu à se hisser au sommet de la A-List. Selon les opportunités, ses choix se révèlent audacieux (Frequency, Far from heaven) ou carrément calamiteux (voire récemment le consternant Cold Creek Manor).
Guère plus cher, car toujours en devenir depuis sa révélation dans Donnie Darko, Jake Gyllenhaal devrait monter sa popularité suite à son exposition au premier plan de cette superproduction. Sa future collaboration avec Ang Lee aux côtés de Heath Ledger devrait également y contribuer.
Ratification :
Rappelons pour la forme que l’accord de Kyoto visant à réduire la production de gaz à effet de serre n’a toujours pas été pris en considération ni par les USA, pas plus que par Australie mais pas moins que par la Russie. Sa portée s’en trouve donc grandement amoindrie…
Projets :
L’infatigable Emmerich tenterait de coller à la vague péplum, en axant son prochain long métrage du côté de l’Egypte antique sur laquelle régnait le célèbre Toutankhamon. Gageons qu’il fera pire que son concitoyen Petersen avec l’empire troyen, il en a en tout cas largement les moyens…
|
|

|
 |
DE BEAUX LENDEMAINS
“Tu ne surveilles pas la météo?
- Le temps ne change pas à L.A. »
Nourrissant un appétit certain pour la destruction massive, le besogneux Roland Emmerich arrivé à un point de non retour finissait par se demander ce qu’il pourrait encore massacrer après avoir ruiné la maison blanche dans Independance day ainsi que les rues de New York sous les pattes de son Godzilla. En même temps depuis sa dernière niaiserie, la grosse pomme avait subi d’autres outrages que les assauts d’un gros lézard et peu évident que le public américain apprécie encore de voir son territoire réduit en cendres par des envahisseurs étrangers, aussi fantaisistes soient-ils. Trop accro pour décrocher, le bricoleur teuton se couvre donc aujourd’hui de l’alibi écologique pour poursuivre son défoulement filmique. D’un naturel plutôt gonflé, il va même jusqu’à prétendre livrer avec The day after tomorrow une fable visionnaire destinée à prévenir les populations industrialisées du danger que représente leur mode de vie pour l’équilibre naturel. On aura du coup eu droit en projection presse, après une sympathique fouille au corps en règle à l’entrée (faudra t-il un jour baisser son pantalon pour visionner un film de la Fox ?), à un cours de vulgarisation pour météorologue alarmiste en herbe. L’intervention informative prête à sourire. Chercherait-on à nous faire passer Emmerich pour un cinéaste doté d’une conscience? Ce serait exagéré à la vue du résultat de sa nouvelle livraison passablement affligeante (pour changer). La posture altruiste de l’homme qui a fait son chemin dans l’âge, Emmerich l’a repiquée paresseusement à Spielberg, son modèle de toujours. Evolution logique d’un faussaire sans inspiration qui meublera immanquablement sa nouvelle contrefaçon des plus récentes trouvailles du wonderboy (au choix, une séquence de Jurassik Park, quelques unes de A.I.). Il fera de multiples autres emprunts, recyclant dans son sandwich apocalyptique l’essentiel du cinéma catastrophe de ces dernières années (Twister + Armaggedon + Deep Impact, le tout avec du ketchup et des frites ?). Dans la tendance accumulative, Emmerich est au moins totalement en phase avec son époque puisque Hollywood, en peine dans la surenchère innovante, s’emploie ces derniers temps dans la compilation façon menu de fast food. Universal se sent obligé de convoquer l’intégralité de son bestiaire pour Van Helsing, Tarantino fait ses fonds de tiroir avec Kill Bill pour Miramax et enfin la Fox (encore elle !) s’apprête à nous accoupler Alien et Predator. Quant à savoir si le public se relèvera de cette indigestion avec une once de satisfaction ou un rôt annonçant le renvoi…
Le fait est que The day of tomorrow confère à l’indifférence avec ses effets démesurés qui n’impressionnent plus et ce malgré l’abattage numérique forcené. Son script balourd n’aidant pas à s’immerger dans son chaos. Un scientifique de premier ordre qui abandonne ses fonctions et ses concitoyens en plein drame climatique, préférant secourir dans un élan paternaliste tardif son fils hypothétiquement survivant, quitte à sacrifier ses plus proches collègues sur le chemin (non pas Le Soldat Ryan !!) ça n’engage pas à une très grande considération. L’ensemble est filmé platement, le plus souvent une succession mécanique de plans fixes au travers desquels chaque interprète effectue le minimum syndical faute d’une direction d’acteur. Il n’est pas question ici d’impliquer le spectateur dans une dramaturgie rigoureuse, des situations audacieuses, mais uniquement de l’assommer à grand renfort d’épate pré storyboardée et de bons sentiments basiques. Confus et trop disproportionné pour émouvoir par un semblant de vraissemblance, le film est loin de pouvoir prétendre attirer l’attention par ses seules qualités artistiques. C’est dans le concept marketing (campagne monstrueuse une fois de plus) qu’il faut chercher du talent chez Emmerich.
Peu conscient du désastre qu’il a orchestré, pas plus que du ridicule de sa position (un faiseur totalement au service des studios qui saccage d’un coup de tornade le logo Hollywood sur la célèbre colline, c’est contradictoire et définitivement présomptueux), Roland Emmerich restera très fier de sa scène « engagée » au cours de laquelle on voit les rescapés américains franchir le Rio Grande pour fuir la tempête de froid, singeant en sens inverse les immigrants mexicains clandestins. Oh la belle leçon (impossible d’écrire subversive tant c’est souligné) infligée à l’impérialisme de la plus grande puissance économique mondiale. Pas évident pourtant que le message délivré façon cheveu mélangé dans une soupe de nouilles change le cours l’histoire (à commencer par celle du cinéma) ou au moins favorise par la puissance supposée de la symbolique satirique, la ratification du traité de Kyoto par l’oncle Sam. Le jour où Roland Emmerich se confondra avec Michael Moore, la banquise aura probablement eu le temps de faire monter le niveau des océans.
| |
 | |
| |
|