 |
| 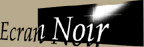 |
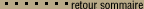 | |
 |
 |
Production : Claude Berri
Distribution : Pathé
Réalisation : Frédéric Auburtin
Scénario : Laurent Touil-Tartour
Montage : Guy Lecorne
Photo : Willy Stassen
Décors : Christian Marti
Son : Pierre Gamet
Musique : Jean-Yves d'Angelo
Effets spéciaux : Frédéric Moreau
Maquillage : Turid Follvik
Durée : 95 mn
Casting :
Gérard Lanvin :San Antonio
Gérard Depardieu :Bérurier
Valéria Golino :l'italienne
Michel Galabru : Achille
Barbara Schulz : Marianne
Robert Hossein : le ministre
Michèle Bernier : Berthe
Eriq Ebouaney : Jeremie Blanc
Luis Rego : Pinaud
|
| | 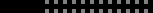 |
|
 |
|
|
|
       |
|
 |
San Antonio
France / 2004 / Sortie France le 21 juillet 2004
|   |
 | 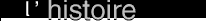 |  |
D’audacieux terroristes menacent de kidnapper les importants personnages de nos sociétés. Judicieusement disposés dans un palace britannique, le commissaire San-Antonio et son fidèle lieutenant Bérurier sont mis au service de l’ambassadeur de France pour s’occuper de sa sécurité directe. Hélas, le fumeux Bérurier, accaparé par sa faiblesse notoire pour les plaisirs charnels, donne l’occasion à une charmante et habile italienne d’enlever le diplomate. De retour à Paris, alors que San-Antonio est démis de ses fonctions par le chef de la police, le président de la République disparaît mystérieusement. Pour le retrouver, les services secrets décident d’embaucher le récent chômeur, désormais en concurrence avec Bérurier qui a prit du Galon chez les condés.
|
|
| | |
 |
 |
Première vraie collaboration de ces deux Gérard de notre terroir (ils s’étaient croisés dans Le choix des armes, d’Alain Corneau), San-Antonio a tous les attributs du film d’été à la française. Cette comédie d’action, déjà assurée d’un certain succès auprès des nombreux amateurs du personnage de Frédéric Dard, bénéficie de la présence de valeurs sûres du peloton cinématographique. En effet, il faut ajouter au duo Lanvin-Depardieu, les participations de Barbara Schultz (Un aller simple), de Valéria Golino (Hot Shots, Respiro), Michèle Bernier, Michel Galabru, Luis Rego, Robert Hossein╔ On y ajoute la présence en bikini d’un casting féminin relativement anonyme mais assez engageant et tout est là pour attirer le chaland.
Laurent Touil-Tartour a acquit les droits de tous les San-Antonio peu avant le décès de Frédéric Dard. Il décide alors de rédiger son premier scénario pour le cinéma. Après deux ans et demi de travail, il présente son scripte à l’illustre Claude Berri qui accepte de le produire. Les velléités de mise en scène de Touil-Tartour sont mises à mal, suite à un désaccord avec la production. C’est alors que Berri fait appel à Frédéric Auburtin qui le remplace au pied levé.
Auburtin est une vielle connaissance du producteur-réalisateur puisqu’il avait été stagiaire, dix-neuf ans auparavant, sur Jean de Florette. Une relation de confiance s’était alors établie puisque le jeune homme fut, par la suite, promu assistant réalisateur sur Germinal et Lucie Aubrac puis sur l’Amant de Jean-Jacques Annaud (produit par Berri). San-Antonio est la deuxième réalisation au cinéma de Frédéric Auburtin, après Un pont entre deux rives.
Tous les moyens ont été mis à la disposition du réalisateur pour conformer le film d’été le plus crédible possible. Les moyens financiers notamment, permettant cascades, courses-poursuites et explosions de circonstance.
|
|

|
 |
JAMES BANDE
« Mais j’voye pas pourquoi qu’on fallait qu’on s’encombrasse de ta géniteuse et d’ma régulière sur cette mission, enfin╔ »
Comment restituer l’originalité essentielle des romans de Frédéric Dard, constructions amusées, chapitres après chapitres, d’histoires et de personnages par une langue détournée, écartelée. C’est une question que ne s’est probablement pas posé Frédéric Auburtin, le réalisateur de San-Antonio. S’il avait été question d’opérer une véritable adaptation d’un roman, il n’aurait pas suffit de rendre le pittoresque et la faconde des personnages à travers des dialogues à la Dard. Le pas supplémentaire aurait été d’ajuster la mise en scène entière au principe argotique de la construction littéraire originaire. Un principe d’auteur qui contaminait initialement tous les secteurs de l’¤uvre : la thématique, la structure, le style de la narration et les dialogues, en dernière instance. Dans le film, les personnages sont biens là et les dialogues aussi mais l’effort d’adaptation ne va pas plus loin.
Les très nombreuses pages de Frédéric Dard (et l’achat des droits qu’elles supposent) sont donc un prétexte à attirer l’attention sur un film à grand spectacle, auxquels Depardieu semble maintenant se consacrer exclusivement. Cette ambition spectaculaire assumée du film est, au bout du compte, une de ses meilleures réussites. Dans le genre, les péripéties visuelles, comme dans cette poursuite de la jeep, sont assez efficaces. Evidemment, le coté systématique de ces séquences peut en lasser certains. Un sentiment de passage obligatoire par la case cascade et carambolage en tous genres peut se manifester, et l’ennui avec. A bien y regarder, le film se déroule selon une logique apparemment bien rodée. Quelques vannes de dialoguiste mènent à un lieu d’investigation qui provoque une course-poursuite, au terme de laquelle surgit une révélation, propice à quelques vannes, etc. Cette structure assez simple tient la route tout au long de cette heure et demi de pitreries.
Malgré l ďévidence des ficelles narratives, le rythme constant de l’action maintient le spectateur normalement constitué en éveil. Les inconcevables rebondissements sont symptomatiques de ce type de cinéma et lorsque l’invraisemblable se produit, il passe presque inaperçu.
L’argot dont abusent les personnages, et particulièrement Bérurier (Depardieu), coutumier du barbarisme extravagant (« Tu connais cette individuse ? ») croisé à l’imparfait du subjonctif, est, bien sûr, l’héritage le plus directe de l’¤uvre de Dard. Ce langage originel est, toutefois, singulièrement allégé de ses formules et termes rares, de son jargon recherché. On ne peut pas reprocher au film de vouloir se faire comprendre par le plus grand nombre. Le comique de San-Antonio est principalement issu des joutes verbales organisées complaisamment par les protagonistes. La drôlerie des livres est respectueusement rendue au spectateur de cinéma, tout comme la grivoiserie outrancière qui règne tout au long de la projection. Sans être puritain, l’attitude générale de Bérurier frise parfois l’obscène mais c’est, semble-t-il, la règle dans la plupart des comédies contemporaines, qu’elles soient françaises ou américaines.
Malgré l’absence de suspense, cette caricature bancale et graveleuse parvient donc à conserver notre intérêt relatif de juillettiste mou. Sans aucun ingrédient exceptionnel, San-Antonio réussit sa mission de divertissement doucement exotique mais échoue, sans scrupule, dans la représentation de quoi que ce soit.
|
|
 | |
| |
|