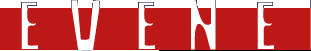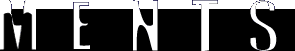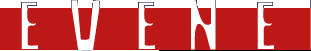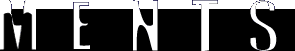|
DECEMBRE 2002
Les Femmes Monstres
La Femme sans Ombre à l'Opéra Bastille et Concha Bonita à Chaillot : de Strauss au Rita Mitsouko.
Vincy
- Opéra Bastille : du 9 décembre au 5 janvier. De 58 à 109 euros la place.
- Théâtre de Chaillot : du 5 décembre au 2 février. De 11 à 24 euros.
La scène subventionnée bénéficie de ressources colossales, de technologies à la pointe, et finalement de décors très vastes pour nous en mettre plein la vue.
De l’Opéra Bastille à Chaillot, les spectacles qui nous sont proposés parlent à des aficionados différents, mais bizarrement, nous laissent le même sentiment. Celui d’un conformisme troublant, d’une absence de folie, d’une distance anesthésiant l’émotion. Comme si le déploiement de moyens écrasait la créativité.
Pourtant le matériau n’est pas de toc. Et les metteurs en scènes appartiennent aux génies autrefois portés aux nues. Les deux souffrent du même défaut : le style existe, mais l’occupation de l’espace et la direction d’acteurs sont indignes du prix de la place (24 euros à Chaillot, 75 euros à la Bastille).
Bob Wilson n’est pas n’importe qui. Un touche à tout de génie, d’architecte au design des sacs Vuitton, il se disperse dans tous les arts, dans tous les pays. On lui doit la mise en scène d’Orlando, avec Huppert. Aujourd’hui tout cela se ressent. La répétition générale de samedi ne donnait pas, certainement, la pleine ampleur de son opéra de Strauss ("La femme sans ombre"). Mais ce scénographe inspiré (là encore les jeux de lumières, les décors font référence) se repose de plus en plus sur les idées de ses collaborateurs, sur les possibilités de la salle que sur une originalité pourtant attendue. Seule concession : le domaine de la magie, illustrée par ces petits enfants faisant griller quelques poissons volants. Mais sinon, tout est pesant. Autant la musique de Strauss est mélodique, séduisante, magnifique, autant sa mise en scène est immobile, répétitive et pesante. Comble de l’ironie, la femme sans ombre apparaît avec une ombre visible. Les ch¦urs ne sont pas mis en valeur. Et tout cet aspect statique nous conduit à nous concentrer sur un texte très pauvre et remarquablement peu captivant. Ce gâchis, tout juste rattrapé par la majesté de certains effets, empêche la symbiose entre l’auditeur et l’¦uvre. On le regrette d’autant plus qu’il faut beaucoup de chaleur pour compenser la grandiloquence vide de cet Opéra.
Alfredo Arias a pris davantage de risque en créant une comédie musicale, supérieure en tout à la soupe marketing servie ses dernières années dans le genre, mais bien loin de ce que l’on pouvait attendre d’un tel artiste. La persécution des minorités, le transsexualisme, la schizophrénie ne font naître aucune subversion, aucune perversion, aucune excitation. Tout cela paraît être un beau livre d’images, où les événements sont lisses et n’appellent à aucune réaction. Là où Almodovar aurait insufflé de l’extravagance, de la flamboyance, du paradoxe, nous n’avons le droit qu’à un divertissement insipide mais coloré. Là encore, les 7 personnages ont du mal à occuper une scène transformée en maison de poupées. De plus, la chorégraphie se limite souvent à des mimiques trop souvent répétées. On frôle plus le cliché que l’originalité. A cela s’ajoute les voix masculines qui ont du mal à percer au-delà du son de l’orchestre. Concha Bonita est cependant un spectacle de Noël de qualité, et le parfait exemple de ce que pourrait être le mélange des cultures élitistes et populaires. Honneur aux femmes, toutes splendides. Claire Perot (dans le rôle de la gamine) amène une fougue en deuxième partie qui booste ces 100 minutes un peu longuettes (le problème d’un livret trop faible). Et Catherine Ringer est formidable, comme peu de françaises peuvent l’être, dans l’excès, la caricature, le jeu de diva. Une showgirl qui cherche la complicité du public. Quelques répliques font mouche par leur vulgarité bienvenue et certains costumes ont le droit à une ovation. C’est presque du théâtre de boulevard, avec la fabuleuse musique de Nicola Piovani (le compositeur oscarisé de la musique de La Vita è bella).
Dans les deux cas, cette Femme sans ombre et cette Concha émasculée, toutes deux attachantes et monstrueuses, se retrouvent un peu seules au milieu de la scène, à gesticuler, déambuler dans le vide. Le style les a admirablement corsetées. Mais le souvenir disparaît comme un parfum qui n’accroche pas à la peau, mais vole dans l’air.
|