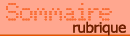

 | LOUIS DE FUNES |
 | IL ÉTAIT UNE FOIS SERGIO LEONE |

A-C D-K L-O P-Z


Octobre 2018
|
IL ÉTAIT UNE FOIS SERGIO LEONE |
|
 |
Il était une fois Sergio Leone Exposition à la Cinémathèque française Du 10 octobre 2017 au 27 janvier 2018 Le monstre, le mythe et le talent
La grande expo de la rentrée à la Cinémathèque s’offre à « bon conte » avec Sergio Leone. Enfant de la balle – au temps du muet, sa mère était comédienne, son père, après voir été acteur, fut cinéaste et même chef du syndicat des réalisateurs – le petit Sergio est tombé dans le cinéma quand il était petit. Et il est resté longtemps le fils de Vincenzo Leone. « Au fond de moi, il y a un enfant, il y aura toujours un enfant » avait-il confié lors de sa Masterclass en 1986 à la Cinémathèque.
Car si Leone est (devenu) un mythe, loué par les plus grands, de Scorsese à Tarantino, c’est parce qu’il a imposé un style singulier et personnel. L’exposition cherche autant à expliquer comment s’est composé son univers qu’à décrypter une œuvre reconnaissable entre toutes. Elle démêle les sources d son imaginaire et décrypte ses fantasmes. Pas évident pour ce « brouilleur de pistes » qui était aussi perfectionnistes et iconoclastes que ses alter-egos Fellini ou Kubrick. Ajoutez une dose de réalité, provenant du néo-réalisme italien, - la poussière, la saleté, un grand Ouest violent et multi ethnique – des dialogues réduits à l’essentiel, et son cinéma déviait déjà des classiques du genre. Au fil de l’expo, on construit le film : sa direction d’acteurs (dans un diptyque photo hypnotique), ses recherches historiques minutieuses et ses anachronismes volontaires, et bien sûr, comme au temps du muet, le son et la musique. Car son image, au large cadre, est avant tout dopée par le son. Le délire visuel est renforcé par des bruits, le jeu des comédiens épouse la mélodie. Tout pour la musique. C’est la musique qui est le dialogue dans ces récits Ennio Morricone a le droit à une étape de l’odyssée de Leone, entre ses westerns et Il était une fois en Amérique, sa grande œuvre qu’il a mis tant de temps à achever.
C’est d’ailleurs ce temps, celui qui passe, celui d’un film, celui d’une vie, qui traverse toutes les thématiques. C’est aussi son exigence artistique qui se révèle tout au long de ce labyrinthe qui se termine sur son film à peine écrit, Leningrad. |
|
- vincy |
|
|
|
 |
|
|
  |
|