Si depuis des semaines, les classements des films sortis en 2019 fleurissent un peu partout dans la presse et les réseaux sociaux, le format court n'y est que trop rarement représenté. D'où l'envie de proposer un tour d'horizon forcément hyper subjectif des courts métrages qu’il fallait absolument voir l'année passée. Pour commencer, voici donc nos courts métrages étrangers préférés !
Acid Rain de Tomek Popakul (Pologne)

En 26 minutes, le réalisateur polonais Tomek Popakul nous fait vivre une immersion effectivement sous acide dans le monde de la nuit, à travers la rencontre entre une jeune fille qui fait la route et un homme étrange au volant d'un mini-bus. Tour à tour peuplée de cauchemars et d’hallucinations, la fuite en avant des deux personnages s’accompagne de vues en caméra subjectives, de couleurs psychédéliques, et d’un travail particulier sur le son pour que tout semble sans cesse faux et inquiétant. Le meilleur bad trip de l'année.
A noter : le film est actuellement visible en ligne.
Are you listening, mother ? de Tuna Kaptan (Turquie)

Une vieille dame est assignée à résidence, obligée de porter un bracelet électronique, mais ne cesse de s'éloigner au-delà de la distance autorisée, provoquant la venue de la police et la multiplication de lourdes amendes à payer. La force du film est de laisser le drame à la porte, latent mais hors champ, pour se concentrer sur les personnages et notamment la très belle relation de complicité qui unit le fils et sa mère. Inattendue, une séquence de danse improvisée vient par exemple éclairer de l’intérieur cette maison dans laquelle les absents occupent une place gigantesque. Un simple carton, à la fin, vient expliquer que l’intrigue est basée sur une histoire vraie, et explique la nature du délit commis par le personnage. Bien sûr cette fin apporte un éclairage tout à fait différent sur le récit, qui se teinte alors d’un discours politique et engagé, et y gagne une profondeur supplémentaire, même si l'on peut déplorer qu’il n’ait pas été possible d’incorporer ces éléments directement à l’intrigue, sans avoir recours à l’effet un peu artificiel de ce texte presque pédagogique.
Daughter de Daria Kashcheeva (République tchèque)
Doublement récompensée au dernier festival d'Annecy, la réalisatrice tchèque Daria Kashcheeva anime elle-même ses marionnettes dans un récit plutôt sombre aux accents réalistes qui met en scène la communication impossible entre une fille et son père. En simulant à l’écran les effets chaotiques d’une prise de vue “caméra à l’épaule”, parfois même en vue subjective, elle place le spectateur au centre de l’action, témoin direct de la relation ratée entre les deux personnages dont les regards peints semblent exprimer toute la douleur du monde.
La Distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos (Grèce)
Une rencontre impromptue dans la nuit. Des visages cadrés en gros plan qui envahissent l'écran. Des dialogues ironiques et décalés. Et l'un des plus beaux plans de fin que l'on ait vu cette année. La Palme d'or 2019 est un film ténu et intimiste à la simplicité désarmante, à la sensibilité à fleur de peau et au minimalisme assumé, entre provocation, humour et séduction.
A noter : le film est actuellement visible sur le site d'Arte
The Little Soul de Barbara Rupik (Pologne)

Un voyage éblouissant de beauté, d'onirisme et de mélancolie au pays des morts en compagnie d'une petite âme tout juste échappée du corps qui l'abritait. Barbara Rupik travaille sur la texture de ses personnages et de ses décors jusqu'à recréer un univers organique saisissant et sublime, cadre dantesque édifiant pour le récit poétique et bouleversant d'une indéfectible amitié post-mortem.
No History in a room filled with people with funny names 5 de Korakrit Arunanondchai et Alex Gvojic (Thaïlande)
Voilà une oeuvre dense, foisonnante et complexe qui aborde la notion de collectif dans la Thaïlande contemporaine. Dans une esthétique très soignée où se mêlent éclairages au néon et magnifique lumière naturelle, il réunit des séquences qui ressemblent à des performances (à l'image de ces "fantômes" qui assistent à une projection nocturne), des passages plus documentaires et même des images d'actualité, dont le fil rouge est un fait divers médiatisé à travers toute la planète, le sauvetage de treize personnes qui étaient coincés dans une grotte inondée par les pluies. Interrogeant cet événement et ses répercussions, le film dérive sur des croyances ancestrales mettant en scène les nagas, ces créatures mythiques de l'hindouisme, et entame une réflexion plus générale sur le monde animal, tel un poème visuel ultra-contemporain et allégorique.
Nuit chérie de Lia Bertels (Belgique)


Par une belle nuit bleutée d’hiver, une poignée d’animaux insomniaques se croisent. Il y a le Ouistiti qui a peur du yéti, l’ours mélancolique, le loup musicien. Tous veillent sous l’éclat majestueux d’un ciel couvert d’étoiles filantes. Avec son esthétique ronde et douce et son camaïeu de bleus, le récit est plus contemplatif qu’initiatique. À la fois plein de spleen et de douceur. À destination des plus jeunes, mais pas uniquement, il rappelle l’inanité des préjugés et l’importance de ne pas passer à côté des belles choses de la vie : une croisière au clair de lune à dos de baleine, la surprise de surmonter ses peurs, la rencontre avec de nouveaux amis. On est conquis par la simplicité, l'intelligence et la justesse de ce conte jamais mièvre, dans lesquels les personnages sont immédiatement attachants, et les dialogues profonds. Sans oublier une mention spéciale pour la musique déchirante jouée par le loup, et la chanson finale du poète maudit.
Past perfect de Jorge Jacome (Portugal)
Dans un dialogue imaginaire et non dénué d’humour, le réalisateur Jorge Jacome (Flores) interroge le mythe de l’âge d’or et la douleur lancinante de la nostalgie. Past perfect remonte ainsi le temps au gré des souvenirs de son personnage, égrenés dans des sous-titres affichés sur l'image mais privés de voix, tandis que défilent à l’écran des images diverses et foisonnantes : une main qui fouille la terre, un palmier flou, une cassette audio qui prend l'eau...
Adapté de la pièce Play de Pedro Penim, que Jorge Jacome a retravaillée en fonction de ses propres questionnements, le film est également une réflexion sur la difficulté de traduire, en mots, mais aussi en images, la sensation très personnelle que l’on appelle nostalgie.
Physique de la tristesse de Theodore Ushev (Canada)

C'est l'un de nos grands coups de coeur de l'année, dont la critique intégrale se trouve ici. Ce film-somme intime et introspectif, qui frôle les 30 minutes de plaisir cinématographique pur, est réalisé dans une technique d'animation unique que le cinéaste est le premier à mettre au point, celle de la peinture à l'encaustique. Jouant sur la perpétuelle métamorphose de l'image et sur la dualité lumière-obscurité, ce récit poignant raconté à la première personne nous entraîne dans les souvenirs d'un narrateur qui se remémore son enfance et sa jeunesse, tout en évoquant le déracinement et la mélancolie prégnante de ceux qui ne se sentent chez eux nulle part.
Screen de Christoph Girardet et Matthias Müller (Allemagne)

La pluie qui s'abat sur le sol, la neige qui tombe en flocons légers, le sable qui s'écoule inlassablement... Des voix qui se succèdent, impérieuses ou autoritaires : "ouvrez les yeux, écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes..." Stimuli lumineux, bruit blanc d'une télé qui ne capte plus de programmes. Les réalisateurs Christoph Girardet et Matthias Müller utilisent des extraits d'images de films qu'ils mêlent aux extraits sonores d'autres films pour réfléchir sensoriellement, par le biais d'une recherche formelle et expérimentale, à l'impact des images sur le corps et l'esprit de celui qui les reçoit. Ils inventent ainsi une forme de séance d'hypnose cinématographique collective forcément hallucinée. Sans trop savoir à quelle expérience on participe (est-on le sujet hypnotisé auquel s'adressent les voix de fiction ou le spectateur réel, incapable de détacher son regard de l'écran ? - l'analogie est aussi forte qu'évidente), on est fasciné au sens le plus fort du terme par cette succession de plans qui nous entraînent toujours plus loin dans la force incommensurable de l'image. On voudrait littéralement que l'écran ne s'éteigne plus jamais, nous permettant de baigner pour toujours dans cette alternance de lumière et d'obscurité capable de nous faire quitter notre corps et voyager bien au-delà des mondes connus sans jamais quitter notre fauteuil.
She runs de Qiu Yang (Chine)
Qiu Yang (Under the sun et A gentle night, Palme d’or du meilleur court métrage en 2017) continue à creuser efficacement le sillon de son cinéma esthétique au classicisme discret. Son film à la beauté formelle édifiante a d'ailleurs sans surprise remporté le Prix du meilleur court métrage lors de la dernière Semaine de la Critique cannoise. On y voit dans des plans composés comme des tableaux à la profondeur de champ quasi inexistante, et où se multiplient les cadres intérieurs à l'image, une jeune gymnaste lutter pour quitter l'équipe à laquelle elle appartient. Visuellement éblouissant.
Volcano : what does a lake dream ? de Diana Vidrascu (Portugal)

L'artiste Diana Vidrascu s'appuie sur des récits et des images de l'archipel des Açores pour interroger les réalités d'un lieu situé sur une zone tectonique en mouvement. A quoi rêve le lac au-dessus du volcan momentanément endormi ? Il se dérobe aux yeux des spectateurs, emporté au son d'une musique lancinante dans des jeux de surimpressions et de projections qui mettent en perspective la géographique et l'histoire de ce petit coin du monde où se manifeste plus qu'ailleurs la volonté toute puissante de la nature. On est comme à l'écoute de ce mystère insondable, yeux écarquillés et sens en alerte.
Wild will d'Alan King (Australie)

Un policier rencontre l’une de ses connaissances dans la rue, trouve son comportement étrange (il est désorienté et ne semble pas le reconnaître), le ramène au poste. C’est là que l’homme révèle sa vraie nature, dans une scène d’une violence inouïe dont on ne voit pourtant rien à l’écran, si ce n’est un reflet flou dans une paire de lunettes posée sur la table. Tout ou presque se joue au niveau sonore, avec des cris et des grognements qui glacent le sang. Mais ce qui est le plus effrayant, c’est probablement le plan qui revient au visage privé de réaction de l'homme, absent à lui-même. Alan King nous emmène au confins de la monstruosité, dans une dimension parallèle où se révèle brutalement le vrai visage de l’être humain, et réaffirme le cinéma comme art du hors champ.



















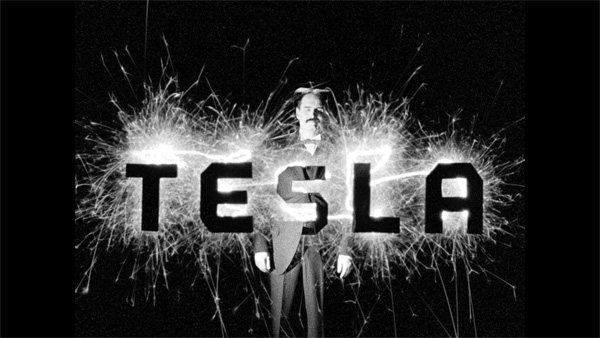




 Flux rss
Flux rss

