Il est temps d'achever ce tour d'horizon des films qui ont marqué l'année 2018 avec un panorama forcément subjectif des courts métrages étrangers qui nous ont tapé dans la rétine !
Amor, Avenidas Novas de Duarte Coimbra (Portugal)

Amor, Avenidas Novas est probablement la meilleure preuve de la subjectivité totale de l'exercice : ce film étudiant du très jeune Duarte Coimbra n’est peut-être pas ce que l’on a vu de plus abouti en 2018, mais sans aucun doute figure-t-il dans la (courte) liste de ce qui nous a véritablement enthousiasmé au cinéma, tous formats confondus. Un grand film pop, attachant et ludique, qui fait preuve d’un charme et d’une candeur irrésistibles en racontant une rencontre amoureuse comme s’il était le premier à le faire. Entre roman-photo et bluette au kitsch revendiqué, le cinéaste multiplie les clins d’œil cinématographiques, dressant dans un même geste, touchant, singulier et inventif, le portrait d’un jeune homme rêveur et celui d’une ville et d’un quartier. Avec une audace qui ne semble jamais artificielle, il réinvente ainsi les contours du romantisme, et réaffirme la capacité intrinsèque du cinéma à (ré)enchanter la vie.
Between us two de Wei Keong Tan (Singapour)

Dans ce récit sensible à la première personne, le narrateur s'adresse à sa mère disparue pour lui avouer son homosexualité. Les souvenirs remontent, les images se mêlent, les visages se brouillent... ne reste que ce qui ressemble à une tentative fragile de remonter le temps pour effacer le regret des non-dits. Les choix formels (notamment l'utilisation de photos et de pixilation, ainsi que de peinture) permettent de situer le récit à la frontière entre les souvenirs du passé, la réalité du temps présent et ce qui est de l'ordre du rêve ou du fantasme.
Hector Malot - The Last Day Of The Year de Jacqueline Lentzou (Grèce)

Si vous nous lisez régulièrement, Jacqueline Lentzou n’est plus pour vous une inconnue : l'an passé à la même époque, nous vous vantions son précédent film Hiwa sélectionné à Berlin. Celui de cette année, qui était à Cannes où il a remporté le prix découverte de la Semaine de la Critique, diffère formellement, mais confirme le talent et la singularité de la jeune cinéaste. Hector Malot est une drôle de chronique intime qui dépeint par petites touches le portrait d’une jeune fille qui semble toujours un peu à côté de sa vie. La tonalité burlesque des scènes qui se succèdent de manière très libre révèle peu à peu la profonde tristesse du personnage. Cette écriture ténue, détachée des contraintes d’une narration classique, permet au film d’être sans cesse sur le fil, regard doux amer sur un personnage dont la fragilité et la maladresse finissent par ressembler à une forme de grâce.
Lunar orbit rendez-vous de Mélanie Charbonneau (Canada)

La plus jolie comédie romantique de l'année nous vient du Canada, avec la rencontre improbable et jamais mièvre entre une jeune femme déguisée en tampon menstruel et un astronaute un peu paumé. Mélangeant road movie, cinéma burlesque et film sur le deuil, Mélanie Charbonneau déjoue habilement les attentes et propose un récit singulier et doux amer, où sensibilité et humour ne cessent de se faire écho avec une grande justesse, et une grosse dose de sincérité.
Le marcheur de Frédéric Hainault (Belgique)

Le marcheur est un film coup de poing porté par une voix-off dense et habitée dont la diction précipitée trahit l'urgence et la colère. C'est l'histoire d'un homme qui, un jour, a décidé de ne plus se résigner. Qui s'est mis en route et n'a plus jamais cessé d'avancer, de marcher, de contester. Peu importe la complexité de sa pensée politique, peu importe la cause. Le marcheur refuse, en bloc, tout ce qui est injuste et laid, révoltant et insupportable. Il ne revendique rien, si ce n'est ce droit à marcher, et à ne plus courber l'échine. Les choix formels sont à l'unisson de cette démarche, refusant un esthétisme gratuit, une "beauté" qui ne collerait pas avec l'âpreté du ton et du sujet. On est à la fois assommé et conquis par cette oeuvre à la puissance politique concrète et immédiate.
The migrating image de Stefan Kruse (Danemark)

A partir d’images trouvées sur les réseaux sociaux ou utilisées par des organismes publics, le réalisateur danois Stefan Kruse explore la manière dont sont perçus et représentés les migrants et réfugiés et interroge cette surproduction d'images autour de leurs drames intimes. Avec une simple voix off d’une extrême simplicité, Stefan Kruse décortique tour à tour les pages facebook des passeurs qui affichent paquebots de luxe et autres mers caribéennes, les films de propagande institutionnels qui misent sur l’émotion en présentant les gardes côtes comme des super-héros ou les vidéos faites par les médias pour alimenter leurs différents supports, jusqu’à des films en 360 degrés pour la page Facebook du journal ou de la chaîne.
Dans cette profusion d’images, chacune raconte (comme toujours) sa propre histoire, au service de celui qui les prend ou les diffuse, plus que de celui qu’elle met en scène. C’est d’autant plus saisissant dans le parallèle dressé entre les images prises au Danemark d’un côté par les défenseurs des migrants, et de l’autre par des groupes d’extrême-droite qui les rejettent, chacun pensant détenir une vérité absolue sur les réfugiés. Sous ses airs faussement pédagogiques, le film amène ainsi le spectateur à prendre conscience de ce qui se joue dans chaque image montrée, et à comprendre la stratégie de communication qui accompagne à chaque étape ce que l’on appelle communément la « crise des réfugiés ». Peu importe si l’on donne de la réalité un aperçu parcellaire et orienté du moment que l’on remporte la guerre idéologique, celle des apparences ou tout simplement de l’audimat.
Rapaz de Felipe Gálvez (Chili)

Tourné en format vertical à la manière d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, Rapaz immerge le spectateur dans un fait divers filmé sur le vif, au beau milieu de la rue : un jeune homme accusé d’avoir volé un téléphone portable est pris à parti par la foule. Le spectateur assiste comme un témoin parmi d’autres à la montée en puissance de la confrontation. Le récit, dense et tendu, va jusqu'au bout de son dispositif, exploitant sans fioritures l’énergie et le sentiment d’urgence de cette forme contemporaine de cinéma-vérité qui témoigne, avec force et sincérité, des dérives de son époque.
Schächer de Flurin Giger (Suisse)

Construit comme un tableau imposant, ce huis clos au rythme volontairement lent et majestueux plonge le spectateur dans une attente anxieuse et intrigante. Tout, de la musique aux larges plans parfaitement composés, participe à l'aspect clinique et froid d'une narration qui évoque irrémédiablement Haneke, mais sans jamais paraître comme un simple exercice de style "à la manière de". Sa force émotionnelle est à la hauteur de cette beauté formelle qui mène implacablement vers un finale métaphysique et terriblement glaçant.
Le Sujet de Patrick Bouchard (Canada)

Réalisé en volume et en pixilation, Le sujet est une expérience cinématographique intense et complexe qui s'ouvre sur un corps inanimé sur une table de dissection. Patrick Bouchard découpe et sonde le moulage de son propre corps pour une introspection intime sidérante qui révèle d'étranges mécanismes. L’artiste, face à lui-même, explore ses doutes, ses souvenirs, ses failles, ses espoirs, et parvient peut-être à déterminer ce qui le pousse à créer, ou au contraire l’empêche d’avancer. Dans le même temps, il met à nu la marionnette, cet objet animé dont on se demande souvent si elle a une âme.
Third Kind de Yorgos Zois (Grèce)

Yorgos Zois imagine un récit de science fiction dans lequel la terre est devenue un lieu mystérieux et inconnu, abandonnée depuis longtemps par l’humanité. Lorsqu’un étrange signal semble pourtant y être émis, trois archéologues spatiaux font le voyage retour. Ils découvrent dans les vestiges d’un ancien aéroport tout un pan de l’histoire humaine encore bien vivante. Notre présent actuel devient alors, pour les personnages, un passé obscur à reconstituer. Comme une façon de nous projeter face à l’Histoire et à la manière dont elle jugera notre époque et ses manquements. Toujours aussi formellement virtuose et inspiré, le cinéaste grec transcende son sujet par une utilisation à la fois minimaliste et monumentale des codes du Space opéra.
Torre de Nádia Mangolini (Brésil)

Le récit intime d'une famille se mêle à la grande Histoire dans ce très beau documentaire animé qui donne la parole à quatre membres d'une même fratrie. Par flashs-back successifs, ils tentent chacun à leur tour de reconstituer le portrait de leur père disparu sous la dictature militaire brésilienne, et racontent leur vécu respectif de la période durant laquelle leur mère fut elle-aussi emprisonnée. L'animation permet de combler les vides et les absences, prenant le relais d'une mémoire défaillante ou au contraire insupportable. On est à la fois avec eux, dans le drame privé qui les touche, et face à l'un des pires moments de l'histoire récente, dont l'actualité politique brésilienne nous fait nous souvenir avec plus d'acuité que jamais.
Un jour de mariage de Elias Belkeddar (Algérie)

Le personnage principal d'Un jour de mariage a quelque chose d’un cow-boy solitaire et las traînant élégamment son spleen dans les rues d’Alger. On suit ce voyou en exil dans un récit fragmenté aux allures d’errance existentielle qui se soucie moins de raconter une histoire que de capter des sensations et des ambiances. La chronique est forcément ténue, esquissée à toutes petites touches, mais elle fait preuve d'une sensibilité à la douceur communicative.
III de Marta Pajek (Pologne)

On le sait depuis l'année précédente et le choc ressenti face à Impossible figures and other stories II, Marta Pajek est une réalisatrice surdouée qui excelle dans les films métaphysiques épurés et minimalistes. Qu'il n'existe pas (encore) de volet intitulé I importe bien moins que le bonheur qu'on a eu à la retrouver en sélection officielle à Cannes en 2018 avec ce III qui n'a pas grand chose d'une suite, tout un posant un nouveau jalon dans sa recherche formelle et esthétique. Après avoir invité le spectateur à sonder les méandres de son propre labyrinthe intime, la réalisatrice propose cette fois une drôle de plongée dans le tourbillon de la séduction et de l'amour véritablement charnel en mettant en scène des personnages polymorphes (un homme, une femme, dessinées dans des tons noir et blanc) qui se rencontrent dans un décor dépouillé qui pourrait être celui d’une salle d’attente. Le film nous entraîne alors dans un troublant et intense ballet amoureux aux accents presque cannibales.
A noter enfin que certains films ayant connu une belle carrière en 2018 figuraient déjà dans notre classement 2017 !
















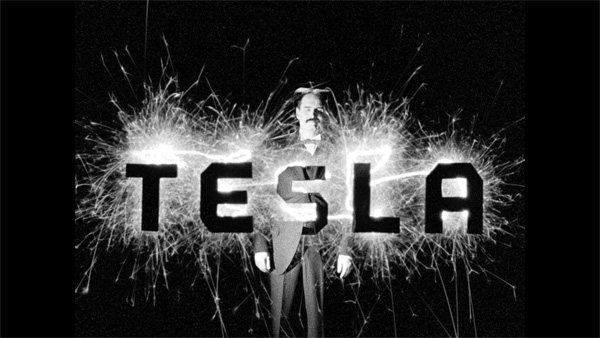




 Flux rss
Flux rss

