A l'occasion de cette pause estivale, Ecran Noir part à la rencontre du cinéma d'animation. Six réalisatrices et réalisateurs de courts métrages parlent de leur travail, de leurs influences et du cinéma en général.

Pour ce quatrième épisode, nous avons posé nos questions à Justine Vuylsteker, cinéaste d'animation française révélée en 2015 avec Paris, l'un des films de la collection « En sortant de l’école » consacrée à Robert Desnos, qui mêlait papier, sable et végétaux.
Après s'être familiarisée avec la technique spécifique de l'écran d’épingles lors d'un atelier donné par la réalisatrice Michèle Lemieux à Annecy, elle a réalisé son premier court métrage professionnel avec cet objet unique et singulier qui permet de travailler directement la matière et de littéralement sculpter les ombres. Le film, bien nommé Etreintes, a fait sa première mondiale à Annecy en juin dernier. Il s'agit d'une oeuvre à l'extrême délicatesse, qui revisite dans un jeu intime et sensuel de noirs, de blancs et de gris, le motif universel du désir et des élans amoureux.
 Ecran Noir : Comment est né le film ?
Ecran Noir : Comment est né le film ?
Justine Vuylsteker : Ce film est né d’avoir pu travailler avec un outil comme l’écran d’épingles. C’est en ayant été confrontée à cet instrument, ses possibilités plastiques et son histoire, que la première étincelle, qui a donné ensuite Etreintes, a pu jaillir. On pourrait presque dire que le film est la mise en forme des sensations que j’ai ressenties en travaillant avec l’Epinette, l’extrême sensualité de sa matière, l’ambiguïté de sa force et de sa fragilité simultanées et le sentiment de m’engouffrer dans une temporalité où présent et passé se confondent.
EN : Justement, Etreintes est le premier film réalisé en France avec un écran d'épingles, depuis la disparition de ses créateurs Alexandre Alexeïeff et Claire Parker au début des années 80. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette technique singulière ?
JV : Les écrans d’épingles sont effectivement des instruments rares, fruits de la rencontre d’Alexandre Alexeieff et Claire Parker, qui ensemble, ont passé leurs vies à inventer et perfectionner cette technique si singulière : utiliser des épingles pour pouvoir sculpter leurs ombres, et réussir à animer des blancs, gris, noirs, d’une extrême richesse. Après la mort du couple, il n’est longtemps resté qu’un seul écran en activité, celui qu’ils avaient confié à l’Office national du Film du Canada. C’est grâce à l’initiative du Centre national de la Cinématographie et à l’effort conjugué de Jacques Drouin et Michèle Lemieux, les cinéastes de l’écran montréalais, qu’un autre écran Alexeieff-Parker a pu refaire son entrée dans le paysage de la production d’animation. C’est seulement en 2015, après plusieurs années de restauration, que l’Epinette, dernier écran construit par le couple en 1977, a pu être remis entre les mains de réalisateurs.
EN : L'écran d'épingles impose des contraintes spécifiques. Dans quelle mesure a-t-il influé sur les choix esthétiques et le résultat final ?
JV : Certaines de ces contraintes sont d’ordre pratique, comme le temps de chauffe avant l’utilisation, ou l’ergonomie de travail, éprouvante pour les épaules et le dos, ce qui impose des journées de six heures de manipulation, maximum, sous peine de blessures sur le long terme. Je dirais que les contraintes esthétiques sont plus cachées ; on ne les rencontre qu’en travaillant. J’ai par exemple eu l’effrayante surprise de découvrir au tournage l’impossibilité de réaliser des parfaites verticales, alors que l’un de mes motifs principaux, à l’écriture, était le cadre d’une fenêtre… Mais l’écran ne nous laisse jamais sans solution lorsqu’il nous confronte à l’impossibilité de sculpter ce à quoi l’on avait pensé… alors le cadre rigide est devenu un rideau souple, et le tournage a pu aller de l’avant.
A vrai dire tout est dans ce bout de phrase : « ce à quoi l’on avait pensé ». Les contraintes que l’on dit rencontrer face à l’écran d’épingles, sont bien souvent des contraintes que l’on se crée de toutes pièces, parce qu’on a, en amont, trop projeté en perdant de vue sa matière. Ce sont toutes les choses que j’avais pensées en dehors de l’écran d’épingles qui se sont ensuite révélées infaisables, ou peu intéressantes. L’écran d’épingles a ça de fantastique : on doit construire le film avec et pour lui, sinon c’est implacable, ça ne fonctionne pas. Là où une autre matière courberait l’échine. C’est une très belle leçon que d’avoir dû rester à l’écoute de l’instrument, sans plaquer sur lui des choses qui ne lui correspondent pas.

EN : Quel a été le principal challenge au moment de la réalisation ?
JV : Certainement de travailler avec une structure mouvante, jusqu’à la fin de la fabrication. L’écran d’épingles, par la configuration singulière de tournage qu’il impose, un tête-à-tête réalisateur-matière, a permis de défendre l’idée de ne pas figer le film sous la forme d’un story-board ou d’une animatique, avant même que le dialogue avec l’instrument n’ait commencé. Et même si le travail d’écriture avait été important, et mené dans cette perspective d’improvisation à venir, avancer avec une structure en constante recomposition a été un challenge de tous les jours.
EN : Quel genre de cinéphile êtes-vous ?
JV : Très infidèle au cinéma. Je suis spontanément bien plus attirée par la littérature, la danse, la poésie ou les arts plastiques… alors pourtant que le cinéma est mon médium d’expression. Lorsque ponctuellement je reviens vers les films, c’est souvent très intense, pour ne pas dire boulimique. Je peux ne faire que ça pendant des jours, pour ensuite ne rien vouloir voir pendant des mois. Beaucoup d’inconstances donc, et très peu de mesure !
EN : De quel réalisateur, qu’il soit ou non une référence pour votre travail, admirez-vous les films ?
JV : Michelangelo Antonioni. Et plus que les films, je dirais que c’est la recherche, qui traverse tout son travail et qui se prolonge toujours un peu plus d’un film à l’autre, sans changer d’essence, et sans pour autant se répéter, que j’admire profondément. Il y a d’ailleurs une phrase de lui que je me répétais systématiquement, pendant la fabrication d’Etreintes : "Je déteste ce que je ne comprends pas. S’il y a quelque chose d’énigmatique dans ce que je fais, c’est moi qui me trompe. Le problème est que mes erreurs sont peut-être ce qu’il y a de plus personnel dans mes films." L’erreur comme gage d’honnêteté, alors que la tendance va à l’ultra-perfection, c’est particulièrement inspirant, et émouvant, à lire.
EN : Quel film (d’animation ou non) auriez-vous aimé réaliser ?
JV : Summertime de David Lean.

EN : Comment vous êtes-vous tournée vers le cinéma d’animation ?
JV : Le cinéma d’animation donne la possibilité du travail solitaire. Ce n’est pas une obligation, ni nécessairement une norme, mais c’est une possibilité. On peut faire (les images d’) un film, seul. Et il y a quelque chose là-dedans qui m’attire beaucoup, ou peut-être qui m’est nécessaire. Le silence et la solitude, pour créer. Il y a aussi que le travail de la matière m’est particulièrement cher, et l’animation, c’est exactement ça, de la matière qui s’exprime par le mouvement.
Alors comment j’en suis arrivée au cinéma d’animation ? Par hasard, après avoir vu des oeuvres qui m’ont fait me dire : je veux faire ça ! C’est seulement une fois que j’ai commencé que j'ai réalisé à quel point c’est l’art qui me donne les moyens de mettre le plus justement en forme mon imagination.
EN : Comment vous situez-vous par rapport au long métrage ? Est-ce un format qui vous fait envie ou qui vous semble accessible ?
JV : Pour qui utilise le cinéma comme moyen d’expression, le long métrage, tout ce temps, c’est forcément quelque chose qu’il est difficile de ne pas avoir envie de s’approprier. Mais c’est aussi une énorme responsabilité, que de vouloir remplir tout cet espace, devoir en créer sa densité, sa profondeur, sa structure. Il me semble factice d’envisager le long métrage, pour faire un long métrage. C’est si un projet se forme, qui a besoin de ce temps-là pour respirer et résonner à sa pleine puissance, que la question a seulement raison de se poser.
EN : Comment voyez-vous l’avenir du cinéma d’animation ?
JV : Je crois qu’il y a beaucoup d’avenirs possibles pour le cinéma d’animation. Si aux yeux du grand public, et de la critique, nous sommes longtemps restés dans l’ombre du cinéma de prises de vues continues - en partie à cause de l’étiquette pour enfant posée par l’hégémonie Disneyenne - il y a comme une prise de conscience qui est en train d’opérer, sur ce qu’est, et pourrait être, le cinéma d’animation. Prise de conscience qui peut nous faire espérer l'entrée dans une nouvelle ère, plus adulte, pour cette forme de cinéma. C’est le long-métrage qui porte ici tout l’enjeu de cette métamorphose, puisque le court-métrage est depuis longtemps déjà un formidable lieu de maturité et d’expérimentations. Tous les espoirs sont donc permis, pour le long métrage, et la série d’ailleurs, pour peu que les instances de financements et de diffusion réussissent à s’engager et prendre les « risques » nécessaires pour accompagner cette dynamique vertueuse. Je reste néanmoins sur mes gardes, et ne crierais pas victoire trop vite, parce qu’une telle croissance est évidemment fragile. Il me semble nécessaire d’être vigilant à ce que, dans un tel moment, les exigences artistiques et poétiques réussissent à primer sur les considérations marchandes et financières, si l’on veut véritablement pouvoir dire que le cinéma d’animation est en train de grandir.
 Le Festival international de l'image de Épinal est l’un des plus anciens rendez-vous consacré au diaporama ou “court-métrage photographique” : de sa création en 1961, avec des récits constitués de diapositives passées en fondu-enchaîné sur une bande sonore sur bobine, aux années 2000, avec des montages tout numérique, ce type bien particulier de court a toujours été en évolution.
Le Festival international de l'image de Épinal est l’un des plus anciens rendez-vous consacré au diaporama ou “court-métrage photographique” : de sa création en 1961, avec des récits constitués de diapositives passées en fondu-enchaîné sur une bande sonore sur bobine, aux années 2000, avec des montages tout numérique, ce type bien particulier de court a toujours été en évolution.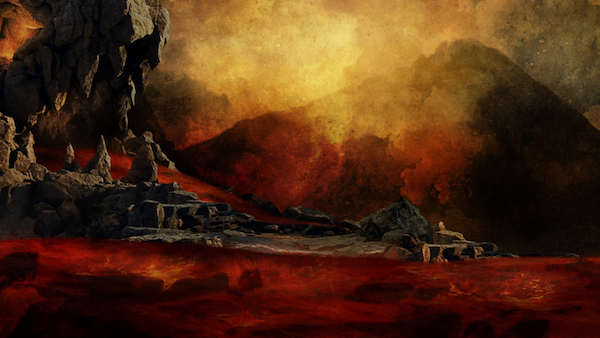















 Flux rss
Flux rss

