 Comme à Ecran Noir on aime vous faire partager nos découvertes, alors après le clip Charmer de la chanteuse Aimée Mann, voici l’instant Court n° 88.
Comme à Ecran Noir on aime vous faire partager nos découvertes, alors après le clip Charmer de la chanteuse Aimée Mann, voici l’instant Court n° 88.
La semaine prochaine arrive le tant attendu nouveau James Bond : c’est le 23e film (50 ans après la sortie du premier), c’est le 3e joué par Daniel Craig qui est le 6e acteur de ce personnage… James Bond est un évènement entouré de chiffres, à commencer par son matricule d’agent secret 007. Mais James Bond c’est aussi d’autres chiffres avec plein de zéros : les millions des publicités.
Dans la franchise James Bond, le placement-produit est intégré au maximum dans les films et les plus grandes marques s’intéressent au personnage pour faire leur publicité. Par exemple le champagne Bollinger est partenaire depuis 1973 dans Vivre ou laisser mourir avec Roger Moore, mais la voiture de 007 n’est pas toujours une Aston Martin. BMW fut la voiture de James Bond dans trois films entre 1995 et 1999 ; l’image BMW apparaît17 minutes dans Demain ne meurt jamais, soit 15% de la durée du film !
Ce nouveau film Skyfall contient donc des pubs pour les voitures Aston Martin et les avions Virgin Atlantic, le champagne Bollinger, le soda Coca Cola zero, la bière Heineken, les costumes Tom Ford, les bijoux Swarovski… Le film est distribué par Sony Pictures Releasing et les diverses filiales de Sony y sont beaucoup représentées avec les ordinateurs Sony Electronics, les téléphones Sony Mobile, et aussi le générique chanté par Adèle dont les disques sont distribués par Sony Music Entertainment. Ces sponsors apparaissent dans le film contre un chèque d’environ 10 millions de dollars. Ces différents placements de produits ont apporté environ 150 millions de dollars pour Meurs un autre jour…
La grande nouveauté de Skyfall qui va faire hurler les puristes de James Bond est sa boisson, c’en est fini de sa célèbre "vodka-martini au shaker, pas à la cuillère" (et du cocktail "vesper" dans Casino Royale) car désormais il préfère boire une bière Heineken ! On pourra considérer James Bond comme un porte-manteau vendu au marketing, mais ce n’est pas nouveau. En réalité la marque Heineken est partenaire de 007 depuis GoldenEye en 1995, mais sa présence s’est fait de plus en plus imposante. Dans les spots publicitaires de la bière, on voyait jouer les personnages annexes comme John Cleese (Q) lors de la sortie de Meurs un autre jour (alors qu'il faisait la promotion de Schweppes pour Permis de tuer), ou les Bond girls Eva Green pour la sortie de Casino Royale et Olga Kurylenko pour celle de Quantum of Solace. L’image du héros James Bond était en quelque sorte protégée, mais ce n’est plus le cas. Cette année le montant du chèque a été augmenté pour que désormais 007 Daniel Craig joue dans une publicité Heineken et que aussi en plus il boive une bière dans le film Skyfall…
Voici donc une publicité pour Coca Cola, un exemple de film publicitaire qui joue avec les codes de James Bond et notamment la narration qui reprend les clichés d’une poursuite typique de 007 :
Crédit photo : image modifiée, d’après un extrait du film Coke 007.





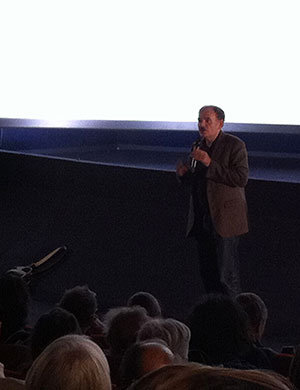


 Flux rss
Flux rss

