70 ans, 70 textes, 70 instantanés comme autant de fragments épars, sans chronologie mais pas au hasard, pour fêter les noces de platine des cinéphiles du monde entier avec le Festival de Cannes. En partenariat avec le site Critique-Film, nous lançons le compte à rebours : pendant les 70 jours précédant la 70e édition, nous nous replongeons quotidiennement dans ses 69 premières années.
Aujourd'hui, J-4. Et pour retrouver la totalité de la série, c'est par là.

C'est un peu la tarte à la crème des polémiques cannoises, la (vaste) question des femmes sur la Croisette. Les éléments, tout le monde les connaît : une seule femme palmée en 69 éditions (mais deux fois, puisque Jane Campion est la seule à avoir réussi le doublé Palme d'or du court et du long métrage), un nombre très faible de réalisatrices sélectionnées en compétition lors de certaines éditions récentes (2 en 2014, 1 en 2013, aucune en 2012), et en gros l'impression que les choses "sérieuses" (la réalisation et l'écriture) sont réservées aux hommes tandis que les femmes sont cantonnées dans le domaine glamour des montées des marches et de la présentation des cérémonies d'ouverture et de clôture.
D'accord, des études le rappellent régulièrement, il est plus difficile pour une femme de vivre de son travail de scénariste et / ou de se voir confier des budgets importants. Moins de films réalisés par des femmes sortent chaque année (moins d'un quart des réalisateurs de longs métrages français sont des femmes, moins de 20% à l'échelle européenne d'après une grande enquête menée en 2014), surtout si on regarde à l'échelle du cinéma mondial. L'offre est donc par définition moins large, et le problème existe en amont de Cannes.
Mauvais bilan

Pourtant, impossible de ne pas remarquer que Cannes est le festival européen d'envergure qui a le plus mauvais "bilan", notamment en terme de reconnaissance des réalisatrices. Rien que ces quinze dernières années, on compte ainsi trois femmes lauréates d'un Ours d'or (Ildikó Enyedi, Claudia Llosa et Jasmila Žbani), deux lauréates d'un lion d'or (Sofia Coppola et Mira Nair), et cinq réalisatrices couronnées d'un Léopard d'or (Ralitza Petrova, Milagros Mumenthaler, Xiaolu Guo, Andrea Staka et Sabiha Sumar). C'est loin d'être parfait, mais c'est toujours mieux que Cannes dont le compteur est bloqué à une dans toute son histoire (et en plus c'était en 1993, soit il y a presque 25 ans).
Malgré tout, on se doit de relativiser : peut-être y-a-t-il tout simplement beaucoup plus de femmes en compétition dans ces autres festivals internationaux ? En fait... pas vraiment. A Berlin, 4 en 2014 (2 à Cannes), 3 en 2015 (2 à Cannes), 2 en 2016 (3 à Cannes), 4 en 2017 (3 à Cannes). A Venise, 2 chaque année depuis 2014. A Locarno, 2 en 2014, 3 en 2015, 6 en 2016. On est très loin d'un début de parité, dans tous les cas. Et on vous passe les plus mauvaises années.
Un palmarès pas folichon

Autre début d'explication: peut-être que la palme d'or est l'arbre trop voyant qui cache la forêt de prix décernés à des femmes ? Après vérification... pas vraiment. Petit calcul rapide. En 69 édition, les réalisatrices en compétition officielle ont récolté :
- trois grands prix : Journal à mes enfants de Márta Mészáros (1984), La forêt de Mogari de Naomi Kawase (2007), Les merveilles d'Alice Rohrwacher (2014)
- un prix de mise en scène : Récit des années de feu de Yuliya Solntseva (1961)
- un prix du scénario : Agnès Jaoui en 2004 pour Comme une image (avec Jean-Pierre Bacri)
- sept prix du jury : Samira Makhmalbaf en 2000 pour Le tableau noir et en 2003 pour A cinq heures de l'après-midi, Andrea Arnold pour Red road (2006), Fish tank (2009) et American honey (2016), Marjane Satrapi pour Persépolis (avec Vincent Paronnaud) en 2007, Maïwenn en 2011 pour Polisse.
A noter que deux comédiennes ont également obtenu ce fameux prix du jury un peu fourre-tout : Irma P. Hall pour The ladykillers (2004) et Catherine Deneuve pour Conte de Noël et l'ensemble de son oeuvre (tant qu'on y est) en 2008.
Si on s'autorise un peu de mauvais esprit, on constate qu'il y a eu plus de prix du jury attribués à des femmes que tous les autres prix confondus (hors prix d'interprétation, évidemment). Mais c'est bien sûr une coïncidence s'il s'agit du prix le moins prestigieux, pensé comme une sorte "d'encouragement" (entre parenthèse, Andrea Arnold doit commencer à se sentir assez encouragée, là, merci).
Et les jurys, dans tout ça ?

Mais si elles sont si mal récompensées, serait-ce parce que les femmes figurent peu dans les jurys ? Oui et non. Par exemple, la première présidente du jury fut Olivia de Havilland en 1965, suivie de Sophia Loren en 1966. À l'époque les femmes réalisatrices ne sont pas pléthores. La première à prendre la tête du jury officiel est Liv Ulllan en 2001. Et encore porte-t-elle les deux casquettes, cinéaste et actrice. Devinez qui fut la première réalisatrice non comédienne appelée à cette haute fonction ? Jane Campion, aka l'éternelle caution féministe de Cannes. En 1979, l'écrivaine Francoise Sagan occupe le poste prestigieux... mais ce sera la seule. Finalement, sur les 69 édition, on en est à... 11 présidentes. En revanche, depuis plusieurs années, le Festival fait attention à choisir des jurys paritaires. Ont été membres du jury (outre de nombreuses comédiennes) les cinéastes Sofia Coppola (2014), Naomi Kawase et Lynne Ramsay (2013), Andrea Arnold (2012), Marjane Satrapi (2008), Lucrecia Martel (2006), Agnès Varda (2005), Moufida Tlati (2001), Nicole Garcia (2000), Doris Dorrie (1999), Nana Djordjadze (1992)... Plus on remonte dans le temps, moins on en trouve. Mais il faut néanmoins mentionner la présence de quelques écrivaines, journalistes et productrices, tout de même.
Par contre, si on regarde du côté des autres jurys, rien que dans les années 2010, on trouve six présidentes cinéastes : Naomi Kawase (Cinéfondation et courts métrages, en 2016), Catherine Corsini (Caméra d'or, 2016), Nicole Garcia (Caméra d'or, 2014), Agnès Varda (Caméra d'or, 2013), Jane Campion (Cinéfondation et courts métrages, 2013), Claire Denis (Un Certain regard, 2010) et neuf "simples membres" cinéastes : Jessica Hausner (Un Certain regard, 2016), Delphine Gleize (Caméra d'or, 2015), Héléna Klotz (Caméra d'or, 2014), Noémie Lvovsky (Cinéfondation et courts métrages, 2014), Daniela Thomas (Cinéfondation et courts métrages, 2014), Isabel Coixet (Caméra d'or, 2013), Maji Da-Abdi (Cinéfondation et courts métrages, 2013), Tonie Marshall (Un Certain regard, 2012), Jessica Hausner (Cinéfondation et courts métrages, 2011). D'accord, certains noms reviennent. Mais on est déjà beaucoup plus près d'une véritable parité. Le constat pourrait donc être que lorsqu'on cherche les femmes à Cannes, il vaut mieux regarder ailleurs qu'en compétition.
Quoi que. Même dans les sections parallèles, tout reste lent. S'il y a 5 films réalisés par des femmes à Un Certain regard cette année, il n'y en avait que 3 en 2016, 3 en 2015, 6 en 2014. A la Semaine de la Critique, on compte 3 réalisatrices pour 4 réalisateurs cette année, mais 1 seule en 2016 et aucune l'année précédente. A la Quinzaine des réalisateurs, 7 sur 20 cette année, 5 en 2016, 3 en 2015. Il faudra encore quelques années pour voir si ce sont les "bonnes" années qui sont exceptionnelles ou si les "mauvaises" se raréfient.
Attention, futures cinéastes en vue

Le pire, c'est que la première sélection d'une réalisatrice en compétition à Cannes remonte à... 1947 (Paris 1900 de Nicole Vedrès). On ne peut pas dire que les choses évoluent très rapidement. Dans la compétition cannoise, en tout cas. Parce qu'ailleurs, heureusement, la situation est plus contrastée. Par exemple, les écoles de cinéma sont aujourd'hui pleines de jeunes femmes qui font jeu égal avec leurs collègues masculins. L'industrie du court métrage (bon indicateur des talents à venir) fait elle aussi la part belle aux réalisatrices. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il y a plus de femmes lauréates de la Palme d'or du court métrage que du long (six films récompensés entre 1986 et aujourd'hui, aucun auparavant) ou si la parité est mieux respectée dans les sélections de courts : cette année, 4 réalisatrices pour 6 réalisateurs à la Semaine de la Critique, égalité parfaite à la Quinzaine des Réalisateurs (5 de chaque), 7 réalisatrices (sur 16) à la Cinéfondation et 3 (sur 9) en sélection officielle.
Cela signifie qu'il existe déjà un vivier de jeunes réalisatrices que l'on devrait voir rapidement prendre position dans la prestigieuse compétition cannoise. On attend maintenant sur le tapis rouge des talents révélés à Cannes les années précédentes comme Julia Ducournau, Deniz Gamze Ergüven, Or Sinaï, Houda Benyamina, Ida Panahandeh, Atsuko Hirayanagi, Claire Burger et Marie Amachoukeli, Clio Barnard, Sandra Hirtt... Et on tient à disposition des différents comités de sélection une liste fournie de jeunes réalisatrices prometteuses à suivre. Si les choses ne changent toujours pas à court terme, on sera en droit de commencer à y voir un système volontairement excluant. Car pour le moment, on a plutôt le sentiment que Cannes est surtout le reflet d'une société où la sous-représentation des femmes à des postes-clef est si intégrée que plus personne n'y fait réellement attention. C'est lorsqu'on commence à y réfléchir avec une once de volontarisme que le problème apparaît.
Femmes sur grand écran

Toutefois, si l'on prend un peu de recul, on constate au fond que l'endroit le plus important où les femmes ont toute leur place, ce sont les films. Ces dernières années, on a rencontré régulièrement de beaux personnages féminins qui, à eux seuls, font plus pour la progression de l'égalité hommes-femmes que bien des discours ou des lois paritaires. Dans l'histoire récente de Cannes, les film, ont même souvent eu des femmes pour personnages principaux. Et pas n'importe quelles femmes !
Impossible de les mentionner toutes, mais citons la résistante inflexible face à des promoteurs immobiliers sans scrupule dans Aquarius (Kleber Mendoça Filho, 2016), les guerrières manipulatrices de Mademoiselle (Park Chan-wook, 2016), la ninja mélancolique de The assassin (Hou Hsiao-hsien, 2015), le couple lesbien de Carol de Todd Haynes (2015) et celui de La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche (2013), les mères étonnement fortes et volontaires de Leonera de Pablo Trapero, d'une Famille brésilienne de Walter Salles et Daniela Thomas et de The exchange de Clint Eastwood (2008)...
Plus généralement, l'air de rien, on a croisé des femmes médecins (La fille inconnue des frères Dardenne, 2016), des cheffes d'entreprise (Elle de Paul Verhoeven, 2016), des juges (La tête haute d'Emmanuelle Bercot, 2015), des réalisatrices (Mia madre de Nanni Moretti, 2015), des photographes de guerre (Louder than bombs de Joachim Trier, 2015), des pianistes virtuoses (Amour de Michael Haneke, 2012), des policières (Polisse de Maïwen, 2011)... Et cette année, on verra même une astro-physicienne dans Les fantômes d’Ismaël d'Arnaud Desplechin. On a tout de même fait un peu de progrès depuis le personnage typique de "petite amie" ou de "mère" du héros.

D'autres beaux personnages féminins ont évidemment marqué l'histoire de Cannes depuis ses origines. Gilda dans le film éponyme de George Cukor (1948), femme libre à la sensualité exacerbée que ses amants ne parviennent pas à dompter ; La cucaracha, pasionaria de la révolution mexicaine interprétée par Maria Felix, comédienne habituée aux rôles hauts en couleurs, dans le film d'Ismael Rodriguez (La cucaracha, 1959) ; la funambule Elvira Madigan, elle aussi éprise de liberté et d'absolu, sous les traits de Pia Degermark (Elvira Madigan de Bo Widerberg, 1967) ; la danseuse Isadora Duncan (Vanessa Redgrave) à l'impressionnante liberté de caractère est saisie devant la caméra de Karel Reisz qui capture l'audace de ses compositions chorégraphiques (Isadora, 1969) ; Alice, emblème des revendications et aspirations féminines dans Alice n'est plus ici de Martin Scorsese (1974) ; la soixantenaire amoureuse et peu soucieuse du qu'en dira-t-on dans Tous les autres s'appellent Ali de de Rainer Werner Fassbinder (1974) ; Yang Huizhen, la valeureuse guerrière prête à tout pour venger la mort de son père dans A touch of zen de King Hu (1975) ; la révolutionnaire, journaliste et théoricienne Rosa Luxemburg chez Margarethe von Trotta (Rosa Luxemburg, 1986) ; Rosetta, la jeune ouvrière en lutte pour retrouver un emploi à tout prix (Rosetta des frères Dardenne, 1999)...
Et au fond, puisqu'il faut bien commencer quelque part, reconnaissons que la présence de ces personnages féminins loin des sentiers battus est un excellent début pour parler de parité. On ne juge jamais un film sur le genre de son auteur, et ce serait un contre-sens de penser qu'une jurée a des goûts diamétralement opposés à ceux d'un juré. En art, il n'y a que des sensibilités variées, diverses et multiples, propres à chaque individu et non standardisées en fonction d'un genre ou d'une origine.
En revanche, ce qui reste d'un festival comme Cannes, ce que le grand public en voit et ce que l'Histoire en retient, ce sont les films, les sujets qu'ils abordent et les personnages qu'ils mettent en avant. C'est donc le point essentiel pour faire évoluer les mentalités. Et à force de voir ces personnages féminins forts, volontaires, brillants et tout simplement dignes d'intérêt sur grand écran, cela contamine naturellement les représentations sociales et les stéréotypes de genre. Jusqu'à rendre possible, demain, la présence de dix réalisatrices en compétition pour la Palme d'or. Chiche ?
Marie-Pauline Mollaret pour Ecran Noir





![20170506_180947[1]](http://archives.ecrannoir.fr/blog/files/2017/05/20170506_1809471.jpg)






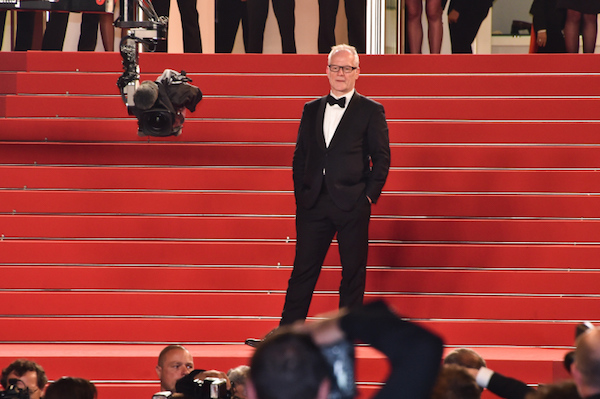

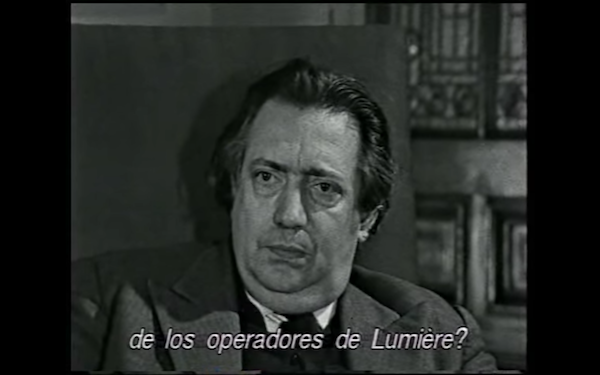








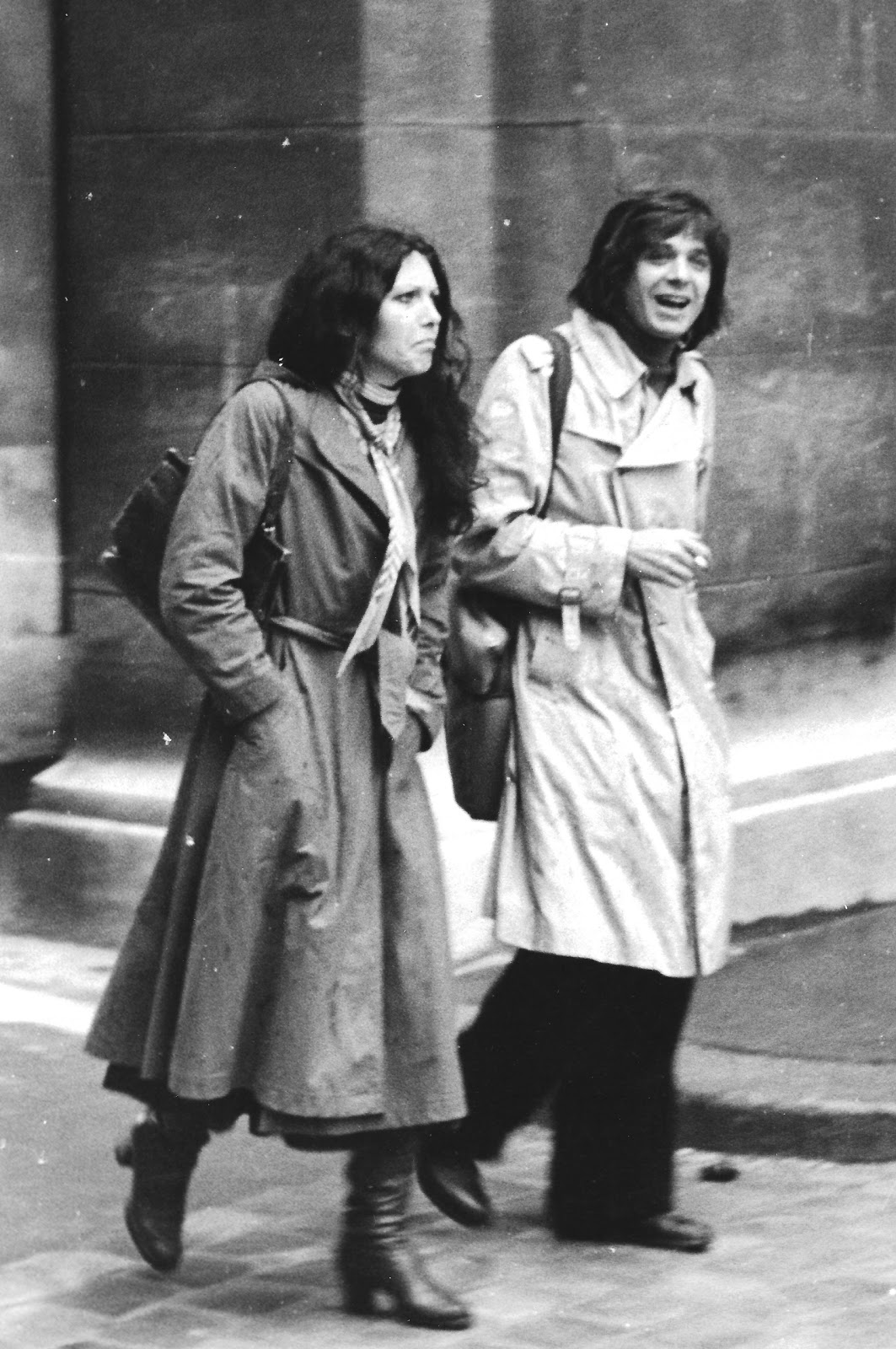





 Flux rss
Flux rss

