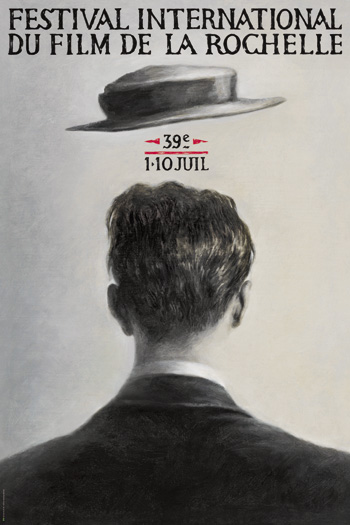 Le Festival International du Film de La Rochelle a fait cette année la part belle aux paysages, de David Lean aux films de Mahamat-Saleh Haroun en passant par quelques inédits qui sortiront prochainement : l’occasion de retraverser le festival sous la forme de cartes postales prenant le pouls de territoires les plus divers.
Le Festival International du Film de La Rochelle a fait cette année la part belle aux paysages, de David Lean aux films de Mahamat-Saleh Haroun en passant par quelques inédits qui sortiront prochainement : l’occasion de retraverser le festival sous la forme de cartes postales prenant le pouls de territoires les plus divers.
Paysage I : le fleuve d’Eternity
Eternity est le premier film d’un émule d’Apichatpong Weerasethakul. Mêmes eaux étranges du fantastique métaphorique, même imaginaire mythologique, même sens du récit mystérieux, mêmes personnages corps flottants… Pourtant, Sivaroj Kongsakul a déjà un style à lui, un je-ne-sais-quoi d’un peu à part. Ses plans séquences larges durent jusqu’à la fascination. Que s’y passe-t-il exactement ? Justement pas grand chose et beaucoup à la fois : un oiseau qui s’envole, une barque qui dérive, un rayon de soleil qui joue entre les feuilles, et peut-être même un mort qui réapparaît fugacement. La force esthétique du film rive le spectateur à cet espace indécidable, entre la vie et la mort. Quand des personnages entrent en jeu – et s’aiment ô combien passionnément – nul besoin de grande déclaration : c’est encore une image qui donne à voir, à sentir les émotions. Deux mains glissent hors des moustiquaires blanches pour se saisir dans la nuit. Plus tard, la douleur ne sera pas dite bien différemment : un plan large de la femme visage baissé suffit à nous faire comprendre son deuil. Peu importe ici si l’histoire est un flashback ou un flash-forward : le temps n’existe pas. Ce que montre le film, c’est un bonheur à jamais figé dans l’instant. Au bord de ce fleuve entre deux jeunes gens qui s’aiment, il y a, comme le clame le titre, l’éternité. Le reste, hors de l’amour, hors du paysage, n’est que ville bruyante et grise – un aller simple vers l’oubli.
Paysage II : les rêves de désert des personnages d’Haroun et de Lawrence d’Arabie
Qu’y a-t-il de commun entre le cinéma du réalisateur tchadien d’Un homme qui crie (2010) et celui de l’anglais David Lean ? Tous les deux ont filmé le désert comme un espace de rêve et de conquête digne des road-movies américains mais avec la dimension visuelle propre au désert : l’infini. Chez Mahamat-Saleh Haroun, les deux frères d’Abouna (2002) contemplent le désert en attendant le retour du père. C’est une ligne infranchissable dans un sens comme dans l’autre. L’un meurt de cette attente (il n’a plus de souffle). L’autre retourne s’occuper de sa mère qui a définitivement sombré dans la folie. Leur père ne sera que rêvé à travers une image de cinéma, un mirage peut-être – une nuque. Ce père pourrait bien être le personnage principal du court-métrage Expectations (2008). Ce qu’il cherche, c’est à atteindre un ailleurs. Mais à l’inverse du père d’Abouna, toujours le désert le renvoie à son village, et de plus en plus endetté. L’infini le rejette et il en devient fou, vidé, amorphe comme d’avoir vu la mort en face. Mais que s’est-il passé exactement dans le désert ?
De même, le Lawrence de David Lean vit une expérience de ses propres limites mentales en même temps que celles du territoire. Lawrence d’Arabie (1962) débute sur une route, la seule vraie route goudronnée de ces presque quatre heures de film : Lawrence meurt dans un accident, puis une image du désert soudain appelle la musique de Maurice Jarre. Le désert, c’est le lyrisme et la folie pure de l’homme, une ligne entre le sable et le ciel. Il agit sur le personnage comme un appel de vie et de mort – le paysage est toujours dialectique, à la fois l’un et l’autre. Il donne en effet la vie au guerrier qui le traverse lors d’un champ contrechamp entre le soleil qui brûle l’image et le personnage silhouette minuscule dans l’immensité. Mais le désert apprend aussi à Lawrence le plaisir de tuer. Il se mire dans le désert au point de revenir tremblant à la civilisation, comme un alcoolique en fin de course. Un personnage ne lui dit-il pas qu’il a l’air beaucoup plus vieux que ses 27 ans ? Qu’a-t-il vécu dans le désert si ce n’est la conscience de la vacuité, la sienne et celle des projets politiques qu’il a cru défendre ?
Paysage III : la mer en colère de La Fille de Ryan
La Fille de Ryan (1970) fait partie des films fleuves de Lean qui avait besoin de durée moins pour développer des sagas romanesques que pour dessiner des portraits cosmogoniques. Dans un petit village irlandais au bord de falaises en 1916, Rosy se marie avec un instituteur plus âgé et peu porté par le désir (Robert Mitchum, tout de même). Elle découvre le plaisir avec un major anglais, un ennemi donc. Mais quel plaisir ! Ce ne sont pas deux corps qui s’unissent mais la nature entière qui jouit : un rayon de soleil traverse les branchages au moment de l’orgasme, un torrent afflue, le fil d’une araignée brille de mille feux. Il y a du Hemingway, qui décrit l’amour physique entre deux êtres faits l’un pour l’autre comme un tremblement de terre, dans cette scène. Plus tard, la mer rejette les armes et la dynamite qu’attendent les Irlandais. Les vagues dans un nouvel élan orgasmique rejettent corps et ferraille dans une scène stupéfiante. Mais le plaisir est de courte durée et les Anglais reprennent le précieux butin porté par l’écume. Cette scène annonce pourtant l’autre mouvement de masse du film : les Irlandais se vengent de l’infidèle Rosy en la lynchant, déchiquetant ses vêtements et cheveux dans une marée humaine. Ils font partie du paysage : aussi durs et solides que les rocs qui reçoivent les ressacs, ils survivent, rejetant les personnages les plus doux... Rosy et son mari, si compréhensif, s’éloignent dans un dernier adieu sur les falaises où seuls sont venus les accompagner le prêtre et l’idiot du village. Les plans larges ici n’ont rien de décoratif ; ils sont l’âme même du film. Les paysages agissent comme le seul témoin véritable. N’est-ce pas grâce aux traces de pas dans le sable que l’instituteur comprend l’infidélité de sa femme ? Ces mêmes pas qui au début du film mènent Rosy jusqu’à lui… Mais les traces s’effacent et la nature impériale reprend ses droits sur ce petit panier de crabes.
Paysage IV : nature humaine, selon Luis Buñuel
La rétrospective consacrée au scénariste Jean-Claude Carrière permettait de se replonger dans quelques grands films de Buñuel. Dans Le Journal d’une femme de chambre (1963), le réalisateur et son scénariste adaptent le roman de Mirbeau comme Renoir quelques années plus tôt, mais pour en faire un film radicalement différent. Là où Jean Renoir filmait une lutte des classes avec une (fausse) légèreté à la Marivaux, Buñuel dénonce l’horreur de l’âme humaine avec une frontalité inégalable. Autant dire que l’humour – tant qu’il y en a – est jaune. Les paysages filmés comme des tableaux hivernaux n’ont rien d’accueillant. Dans la forêt, une petite fille est violée. Il suffit d’un plan elliptique à Buñuel pour dire l’horreur : deux escargots glissent sur une cuisse ensanglantée. Image choc qui dépasse le fait divers pour dresser un portrait de la France glaçant et moderne (on manifeste contre les métèques et le violeur s’enrichit impunément). Le dernier plan du film est d’ailleurs le seul plan de ciel du film : un éclair éclate dans la nuit comme un avertissement de Dieu – ou de ce qu’il en reste. Plus léger, Le Fantôme de la liberté (1974) dénonce les codes bourgeois. La bonne maison française devient le lieu de toutes les perversions, mais des perversions mises en scène, donc acceptables : un couple SM croise des moines joueurs et un neveu amoureux de sa tante dans l’espace étrange d’un hôtel de route. Ici quand la nature intervient, elle est domestiquée : tout commence dans un parc. Pourtant, la dernière image comme une ultime ironie de Buñuel est celle d’un étrange oiseau, un émeu qui regarde la caméra. Ce regard de l’animal au spectateur est le dernier appel du cinéaste qui plus que tout autre aura révélé l’animalité de l’homme. De quoi donner envie de fuir, là-bas fuir…
De là à retourner dans le désert avec Lawrence ou sur le fleuve thaïlandais d’Eternity, il n’y a qu’un pas : c’est loin du monde des hommes, dans la pure contemplation du paysage que le bonheur, seul, peut un instant perdurer.
 A propos de La Ruée vers l’or de Charles Chaplin.
A propos de La Ruée vers l’or de Charles Chaplin. Fait écho à cette scène, un autre grand moment quand Charlot et son ami Big Jim s’endorment dans la cabane qui se déplace pendant la nuit jusqu’au bord d’une falaise. Tout le suspense et le comique indissociables viennent cette fois du rapport entre l’intérieur et l’extérieur. Le plan d’ensemble de la cabane au bord de tomber, vue de dehors, succède au plan d’intérieur montrant les deux personnages inconscients du danger qu’ils courent, jouer à faire basculer leur habitacle. Une fois complètement oblique, retenue par une corde, au bord de sombrer, la cabane devient un espace nouveau : les portes deviennent un aller simple vers la mort ou vers la vie. Les lignes verticales et horizontales sont chamboulées, et les personnages doivent trouver un nouveau moyen d’ouvrir la porte en haut qu’ils souhaitent voir fermer en bas. Il y a quelque chose de régressif et même d’anal dans ce comique : la cabane devient un corps humain recrachant ses habitants ; la nourriture est d'ailleurs l’enjeu de l’intrigue (Charlot faisant bouillir ses chaussures, devenant un poulet aux yeux de Big Jim, ou inventant avec ses fourchettes la fameuse danse des petits pains).
Fait écho à cette scène, un autre grand moment quand Charlot et son ami Big Jim s’endorment dans la cabane qui se déplace pendant la nuit jusqu’au bord d’une falaise. Tout le suspense et le comique indissociables viennent cette fois du rapport entre l’intérieur et l’extérieur. Le plan d’ensemble de la cabane au bord de tomber, vue de dehors, succède au plan d’intérieur montrant les deux personnages inconscients du danger qu’ils courent, jouer à faire basculer leur habitacle. Une fois complètement oblique, retenue par une corde, au bord de sombrer, la cabane devient un espace nouveau : les portes deviennent un aller simple vers la mort ou vers la vie. Les lignes verticales et horizontales sont chamboulées, et les personnages doivent trouver un nouveau moyen d’ouvrir la porte en haut qu’ils souhaitent voir fermer en bas. Il y a quelque chose de régressif et même d’anal dans ce comique : la cabane devient un corps humain recrachant ses habitants ; la nourriture est d'ailleurs l’enjeu de l’intrigue (Charlot faisant bouillir ses chaussures, devenant un poulet aux yeux de Big Jim, ou inventant avec ses fourchettes la fameuse danse des petits pains).


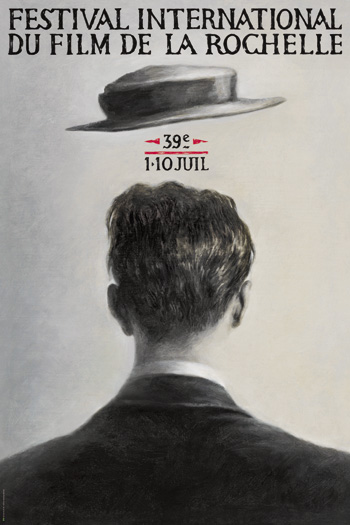


 Le festival de La Rochelle semble être parfois un monde à part, un îlot de résistance contre un certain cinéma dominant. Ainsi, les séances les plus prisées étaient les ciné-concerts autour des œuvres muettes des deux maîtres viennois Erich Von Stroheim et Josef Von Sternberg. Penchons-nous sur l’œuvre du premier dont la modernité donnerait raison aux spectateurs assidus : cette représentation du monde ne vieillira jamais.
Le festival de La Rochelle semble être parfois un monde à part, un îlot de résistance contre un certain cinéma dominant. Ainsi, les séances les plus prisées étaient les ciné-concerts autour des œuvres muettes des deux maîtres viennois Erich Von Stroheim et Josef Von Sternberg. Penchons-nous sur l’œuvre du premier dont la modernité donnerait raison aux spectateurs assidus : cette représentation du monde ne vieillira jamais. 



 Flux rss
Flux rss

