Posté par vincy, le 13 décembre 2009
 China Moses, Liane Foly, Anthony Kavanagh prêtent leur voix au nouveaufilm d'animation de Disney, La Princesse et la Grenouille. Le film vient de sortir aux Etats-Unis, où, avec 27 millions de $ de recettes, il domine le box office du week-end.
China Moses, Liane Foly, Anthony Kavanagh prêtent leur voix au nouveaufilm d'animation de Disney, La Princesse et la Grenouille. Le film vient de sortir aux Etats-Unis, où, avec 27 millions de $ de recettes, il domine le box office du week-end.
Il sortira en france le 27 janvier 2010, pour les vacances d'hiver, période faste pour la fréquentation des salles. On imagine que Disney n'a pas voulu affronter la concurrence d'Arthur et la Vengance de Maltazard, ni même, dans une moindre mesure de Max et les Maximonstres. L'an dernier, Volt, star malgré lui, avait séduit près de 3 millions de petits et grands.
Ici, le marketing insistera sur la dimension "traditionnelle" du dessin animé : on revient aux "classiques" de Disney, avec chanson, princesses et un scénario qui s'amusera avec les contes de princesse. Et surtout une animation dessinée à la main, en 2D : une première depuis La ferme se rebelle en 2004.
Pour la France, c'est donc China Moses, animatrice sur MTV et chanteuse depuis 12 ans, qui sera la voix de la princesse. Mama Odie sera incarnée par la chanteuse, imitatrice et comédienne Liane Foly. Enfin Ray aura la voix de l'acteur et humoriste Anthony Kavanagh, vu récemment dans Agathe Cléry.
Dans la version originale, respectivement, ce sont Anika Noni Rose (Dreamgirls), Jenifer Lewis (déjà entendue dans Cars et Gang de requins) et Jim Cummings (un grand habitué des voix de films d'animation et de jeux vidéos) qui font ces personnages. On y retrouve aussi Oprah Winfrey, John Goodman, Terrence Howard et Bruno Campos.
Le film est réalisé par Ron Clements et Jon Muskers, tous deux co-réalisateurs de La petite sirène, Aladdin, Hercule et La planète au trésor. Ils ont imaginé une histoire dans l'air du temps. Un conte qui se veut moderne. "Une magnifique jeune fille qui s'appelle Tiana (une princesse qui n'a jamais voulu l'être et rêve d'ouvrir son restaurant), un prince grenouille qui rêve de redevenir humain, et un baiser magique qui les entraine tous les deux dans des aventures hilarantes a travers les marais de Louisiane où ils vont faire la connaissance de personnages hauts en couleurs comme Mama Odie et la luciole Ray." C'est ce qu'indique le studio pour vendre cette histoire de princesse black au milieu des bayous.
Tags liés à cet article: anika noni rose, animation, anthony kavanagh, china moses, dessin animé, jenifer lewis, jim cummings, jon muskers, la princesse et la grenouille, liane foly, Marketing, ron clements, the princess and the frog, voix, walt disney.
Publié dans Films, Marketing, Personnalités, célébrités, stars |
Posté par Benjamin, le 13 décembre 2009
Les Rencontres Henri Langlois se veut être un festival ouvert sur les autres cinémas. Des cinémas plus méconnus, moins accessibles mais qui méritent pourtant d'être sous les projecteurs. Et si l'an dernier, c'est l'Afrique qui était à l'honneur, pour cette 32ème édition, c'est l'Asie du sud-est qui est présente à Poitiers.
De nombreuses manifestations de divers "genres" ont été organisées depuis lundi ; à savoir la projection de longs métrages asiatiques tels que Les gens de la rizière de Rithy Panh (lire notre rencontre) et Teak leaves at the Temples de Garin Nugroho suivi par des rencontres avec les réalisateurs. Des temps ont été réservés pour la diffusion de courts métrages issus de différentes écoles d'Asie du sud-est. Des écoles d'ailleurs venues parler de leurs structures, de leurs difficultés à trouver des financements, à trouver un matériel moderne et à trouver une place sur la scène internationale. D'où la grande importance des festivals pour eux, qui sont parfois la seule occasion de se faire connaître hors des frontières de leur pays.
Huit écoles étaient donc présentes à une conférence sur l'enseignement du cinéma en Asie. Huit écoles de six pays différents: Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, les Philippines, le Vietnam et enfin l'Indonésie. Des pays dont vous ne connaissez peut-être rien cinématographiquement tant leur production et leur diffusion sont pauvres. Et toutes ses écoles ont en commun une ouverture très récente (les années 90 pour la majorité) ce qui témoigne de leur retard par rapport à d'autres pays de l'Asie. Un retard qui s'explique par les régimes plus ou moins totalitaires qu'ont connu certains de ses pays. Le Cambodge par exemple sous le régime des Khmers rouges a vu sa production cinématographique réduite à néant. C'est un art qui doit donc faire ses preuves dans ces pays, qui doit conquérir un public et trouver ses réalisateurs. Des institutions qui ont pour volonté de former leurs propres techniciens pour ne pas dépendre d'une aide extérieure.
Des cinémas en éveil qui doivent faire face encore aujourd'hui à des problèmes de censure de la part de leur gouvernement. Des cinémas qui sont donc beaucoup pour le moment des cinémas axés sur le divertissement. Il faudra alors un peu de temps pour voir émerger de ces pays des oeuvres sociales, des oeuvres engagées et totalement libres. Pour le moment, ces écoles peuvent apprécier l'accueil chaleureux et curieux que leur a réservé le public du festival.
Tags liés à cet article: cinéma asiatique, école de cinéma, festival, garin nugroho, Poitiers, rencontres henri langlois, rithy panh.
Publié dans Festivals, Poitiers, formation |
Posté par vincy, le 13 décembre 2009
12 décembre, au coeur de l'Allemagne industrielle, les Oscars européens, appelés European Film Awards, ont été décernés dans la plus grande discrétion. Michael haneke en sort grand gagnant. Il avait déjà emporté le trophée en 2005, avec Caché. Son Ruban blanc remporte les trois récompenses les plus convoitées : film, réalisateur, scénario. Il ne laisse au Prophète d'Audiard que l'intérprétation masculine et un prix d'excellence pour le son. Avec les honneurs pour Loach et Huppert, on aurait pu se croire dans une filiale du Festival de Cannes.
Le public, sans surprise, a voté poru Slumdog Millionaire. Aussi coloré et vif, contemporain et musical que Le Ruban blanc est en noir et blanc, contemplatif, historien et philosophique.
Le Ruban blanc : meilleur film ; meilleur réalisateur (Michael Haneke) ; meilleur scénario
Un prophète : meilleur acteur (Tahar Rahim) ; prix d'excellence pour le son
The Reader : meilleure actrice (Kate Winslet)
Slumdog Millionaire : Prix du public ; Meilleure photographie (ex-aequo)
Antichrist : Meilleure photographie (ex-aequo)
Etreintes brisées : Meilleure compositeur musical (Alberto Iglesias)
Katalin Varga : Prix de la découverte
Mia et le Migou : Meilleur film d'animation
Poste Restante : meilleur court-métrage
The Sounds of Insects - Record of a Mummy : prix ARTE du meilleur documentaire
Tatarak : prix FIPRESCI de la critique
Prix pour l'ensemble d'une carrière : Ken Loach
Prix pour la contribution européenne au cinéma mondial : Isabelle Huppert
Tags liés à cet article: alberto iglesias, Antichrist, etreintes brisees, european film awards, isabelle huppert, kate winslet, Ken Loach, Le ruban blanc, mia et le migou, Michael Haneke, Prix, slumdog millionaire, tahar rahim, un prophete.
Publié dans Films, Personnalités, célébrités, stars, Prix |
Posté par benoit, le 12 décembre 2009
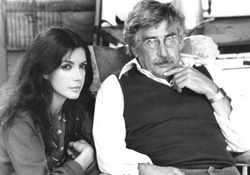 Le cinéaste Gilles Carle s’est éteint le 28 novembre 2009 à l'âge de 80 ans. Handicapé par la maladie de Parkinson, il ne parlait plus depuis cinq ans. En hommage au réalisateur québécois, des funérailles nationales ont été célébrées à la basilique Notre-Dame de Montréal le 5 décembre.
Le cinéaste Gilles Carle s’est éteint le 28 novembre 2009 à l'âge de 80 ans. Handicapé par la maladie de Parkinson, il ne parlait plus depuis cinq ans. En hommage au réalisateur québécois, des funérailles nationales ont été célébrées à la basilique Notre-Dame de Montréal le 5 décembre.
Cher Gilles Carle qui êtes maintenant aux cieux, que votre œuvre foutraque parce que terrestre soit glorifiée à sa juste valeur !
J’émets des vœux pour que le ciné-paradis où vous flottez en Maître soit un foutoir de jugement dernier où les débiles côtoient les putes, les saintes masturbent les vieillards, les anges servent la soupe aux proxénètes et les plus belles femmes du monde avancent toute nue sur les nuages avec des cornes d'orignal sur la tête.
Federico Fellini certifiait que l’Antiquité hante à jamais l'Italie, qu'il suffit de gratter le maigre vernis de sa civilisation pour découvrir un univers archaïque, barbare et païen. Vous, cher Gilles Carle, déclariez que le Québec a toujours de la boue dans le cerveau et des épines de sapin collées à l'âme. C’est pourquoi votre filmographie cède à toutes les démangeaisons, ne cesse de bondir dans tous les sens, épouse toutes les allées et venues des évolutions et révolutions. Comme La Vraie Nature de Bernadette où Micheline Lanctôt, petite-bourgeoise, quitte la ville pour la campagne. Lave son linge sale dans la rivière, s'adonne au régime végétarien et à l'amour libre. Comme dans La Mort d'un bûcheron où déboule Carole Laure, une rurale dans la jungle montréalaise qui pervertit au passage Maria Chapdelaine, le mythe de Louis Hémon, sous fond de déforestation.
Les mâles, les femelles, les Rouges, les Blancs, les ouvriers, les patrons, les nantis, les paumés, vous avez plongé toutes les figures inoubliables de votre monde dans une même mare de sperme, de sang, de rires, de larmes et de sueur. À l’image du pays dont vous êtes le plus grand cinéaste à ce jour. Ce Québec écartelé entre américanisme et franchouillardise qui n’en finit pas de courir après son identité, et n'arrive jamais à se poser. Comme votre œuvre, cher Gilles Carle, un western à la Fellini, capoté, désenchanté, bordélique, libre et magique !
Tags liés à cet article: carole laure, deces, fellini, Gilles Carle, La Mort d'un bûcheron, La Vraie Nature de Bernadette, québec.
Publié dans In memoriam, Personnalités, célébrités, stars |
Posté par Benjamin, le 12 décembre 2009
 Il est en quelque sorte l'invité d'honneur de ces 32ème Rencontres Henri Langlois qui cette année présente un focus sur l'Asie du sud-est. Rithy Panh (réalisateur dernièrement d'Un barrage contre le Pacifique, adaptation du roman de Marguerite Duras avec Isabelle Huppert) est donc présent pour parler de nombreuses choses, de son cinéma tout d'abord, de son centre Bophana qui forme des cambodgiens aux techniques du cinéma, mais surtout il parle de sa mission de cinéaste, il parle du monde et de ses engagements.
Il est en quelque sorte l'invité d'honneur de ces 32ème Rencontres Henri Langlois qui cette année présente un focus sur l'Asie du sud-est. Rithy Panh (réalisateur dernièrement d'Un barrage contre le Pacifique, adaptation du roman de Marguerite Duras avec Isabelle Huppert) est donc présent pour parler de nombreuses choses, de son cinéma tout d'abord, de son centre Bophana qui forme des cambodgiens aux techniques du cinéma, mais surtout il parle de sa mission de cinéaste, il parle du monde et de ses engagements.
"Rétablir la mémoire".
Rithy Panh est venu rencontrer le public poitevin après la projection d'un de ses films, Les gens de la rizière (1994) mercredi 9 décembre. Le lendemain matin, c'est autour d'une assemblée de lycéens et d'étudiants qu'il s'est exprimé sur son cinéma et ses motivations.
Dans presque tous ses films (qu'ils soient documentaires ou de fictions), Rithy Panh accorde une grande importance au savoir, aux traditions ainsi qu'à l'Histoire de son pays, le Cambodge. Pays qui a vécu le dramatique épisode des Khmers rouges. Un régime totalitaire qui non seulement a détruit l'industrie cinématographique mais qui a conduit à la mort des dizaines de milliers de cambodgiens et déchiré tout un peuple. Depuis, Rithy Panh met tout en oeuvre pour instruire les siens par le cinéma et pour sauvegarder l'Histoire de son pays que beaucoup ignorent. Car dit-il en parlant des cambodgiens: "s'ils n'ont pas de culture, qu'est-ce qu'ils vont vendre ? Leurs corps ? [...] Vous allez vendre votre force, votre corps et votre sang si vous n'avez pas de culture." Et les enfants qui n'auront pas eu accès à l'éducation finiront, selon lui, à l'usine à faire des nike pour les garçons et au bordel pour touristes pour les filles.
Rithy Panh a véritablement insisté sur l'état du monde actuel qu'il juge assez déplorable car la "diversité des regards disparaît" selon lui et les petites gens sont de plus en plus écrasés. Car pour lui (et cela se remarque très bien à travers ses films), le plus important est d'aller à la rencontre des gens et non de filmer la Terre d'un hélicoptère comme l'a fait dernièrement Yann Arthus-Bertrand et que Rithy Panh qualifie "d'écologie esthétisante". Pour lui, c'est distance mise avec l'homme ne peut toucher.
"La mémoire des gestes".
Dans Les gens de la rizière, mais dans d'autres de ses films, Rithy Panh se concentre sur les paysans, sur les plus démunis qui travaillent la terre de leur main et qui se battent à la fois contre les éléments et contre le gouvernement pour survivre. Des petites gens à qui il rend toute leur dignité en les accompagnant de sa caméra dans leur quotidien et en s'attardant beaucoup sur leurs gestes. Il veut "être avec les gens, être à la bonne distance où l'on peut les toucher" et donc rendre compte de leur vie avec le plus de respect possible et par deux fois il citera Gandhi: "la générosité, ce n'est pas de donner aux gens, c'est de ne prendre que ce dont on a besoin."
Un cinéaste très porté sur l'humanité et qui veut transmettre "la mémoire dans les gestes et dans le corps". Par exemple, pour une des séquences de S 21: la machine de mort Khmer rouge, l'un des anciens bourreau refait à l'identique les gestes qu'ils affectuaient lors de son activité. Dans une sorte de transe, il revit en quelque sorte, son ancien métier et expie ses fautes. Rithy Panh explique aux étudiants que cette séquence n'était originellement pas prévue mais que l'ex-gardien, ne parvenant pas à expliquer ses "actions", c'est la retranscription visuelle, bien plus frappante, qui fut choisie. Par les gestes, on sauvegarde une certaine époque, une manière de faire disparue que l'on peut alors transmettre aux générations nouvelles.
Rithy Panh défend donc l'Histoire (et critique au passage la réforme du gouvernement en la matière) car c'est de là que vient l'idendité d'un peuple. D'autant plus important pour un pays comme le Cambodge dont on parle peu. Le cinéaste asiatique se positionne donc fermement contre les tendances actuelles et continuera à éduquer les plus petits pour leur donner une chance d'exister de façon moins pénible.
Tags liés à cet article: cambodge, cinéma asiatique, documentaire, festival, interview, Poitiers, rencontres internationales Henri Langlois, rithy panh, Yann Arthus-bertrand.
Publié dans Festivals, Personnalités, célébrités, stars, Poitiers |
Posté par geoffroy, le 11 décembre 2009

Évènement de cette fin d'année ? Pas seulement parce que le réalisateur de Titanic revient après 12 ans d'absence. Pas seulement pour son budget hors-norme. Pas seulement pour son imposant plan marketing (quoique... nous avons connu pire). Le film en lui-même est un spectacle dans lequel on se laisse facilement embarqué, malgré quelques défauts (l'aspect binaire de certains personnages, quelques situations caricaturales). Le scénario est plutôt captivant même si on est immergé dans une science-fiction on ne peut plus classique (pour ne pas dire un peu prévisible). De Jurassic Park au Seigneur des anneaux, Cameron remixe quelques séquences hautes en couleur de blockbusters du genre. Surtout il s'inspire des mangas, de Ghost in the Shell à Miyazaki, pour la trame, la philosophie et la morale. Le cinéaste, d'ailleurs, a choisi un héros handicapé, en quête d'identité, agent triple qui le conduit au dilemme de trahir sa patrie d'adoption ou sa Nation.
Mais le film vaudra surtout pour sa 3D. Pour la première fois, l'usage du relief s'avère pertinent sur de nombreux plans, et semble justifier sur les deux tiers du film. Les effets spéciaux sont alors mineurs comparés aux effets visuels et à une esthtéique très proche du jeu vidéo.
Que tous les fans de James Cameron se réjouissent, de nombreuses avant-premières d’Avatar vont être proposées partout en France le mardi 15 décembre à 21h, veille de la sortie du film en salles. Pour savoir si votre ville diffusera le film en avant-première, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien.
D’autre part, les exploitants, à l’exception notable d’UGC, ont mis les bouchées doubles et pas moins de 250 écrans (sur les 720 prévus à ce jour pour la sortie) sont d’ores et déjà prêts à recevoir le film en 3D. C'est un record puisque le Drôle de Noël de Scrooge n'en avait obtenu que 147 et L'Age de glace 3 en avait eu 122. Le film de Zemeckis fait 43% de ses entrées en 3D tandis que le dessin animé a fait 26% de sa fréquentation avec ce procédé (soit 2 millions d'entrées : un record à battre).
A noter que l'exploitation d’Avatar au Grand Rex débutera le mardi à partir de 23h30. 2h45 de pur plaisir. Bienvenue sur Pandora.
Tags liés à cet article: 3D, avant premiere, avatar, grand rex, James Cameron, salles de cinéma.
Publié dans Films, Marketing, exploitation, salles de cinéma |
Posté par vincy, le 11 décembre 2009
Sans surprise ou presque. Jacques Audiard ne semblait pas étonné au premier étage du Fouquet's quand il a reçu son Prix Louis-Delluc du meilleur film français pour Un prophète. Gilles Jacob lui a remis son grand papier, quelques mois après le rouleau du festival de Cannes (Grand prix du jury). Le 67e prix de cette liste prestigieuse. En fait, la surprise provenait du fait qu'Audiard ne l'avait jamais reçu. En 2001, les jurés ont préféré Intimité (Chéreau) à Sur mes lèvres et en 2005, Les amants réguliers (Garrel) à De battre mon coeur s'est arrêté.
Audiard a donc rendu hommage à la critique. "Je suis très touché de recevoir le Delluc, c'est un beau prix, un prix de la critique. Comme produit d'une réflexion, la critique est indispensable au cinéma. Le cinéma est devenu adulte par elle. Aujourd'hui, la critique manque d'espace, elle est remplacée par la communication sur des produits... ça fout les jetons."
"J'ai voyagé avec mes films. Et il y a des endroits au monde où il n'y a pas de critiques ; il n'y a pas de cinéma aussi."
Audiard avait face à lui les films de Xavier Giannoli, Bruno Dimont, Alain Resnais, Alain Cavalier, Claude et Nathan Miller, Christophe Honoré et Philippe Lioret.
Autant dire qu'il y aura peu de suspens cette année aux César.
En revanche, les jurés ont étonné tout le monde avec le prix Louis-Delluc du premier film. En effet, l'heureuse élue, Léa Fehner, n'était pas dans la liste des quatre finalistes (Adieu Gary, Les beaux gosses, Espion(s), Rien de personnel). Avec Qu'un seul tienne et les autres suivront, qui vient de sortir en salles, le jury espère sans doute réitérer le coup de pouce donné l'an dernier à L'Apprenti, surgit de nulle part et à peine diffusé dans les cinémas français.
Il le faudra. Car si Un prophète a déjà rassemblé 1 220 000 spectateurs, Qu'un seul tienne n'a séduit que 640 parisiens mercredi dernier.
Tags liés à cet article: gilles jacob, jacques audiard, kea fehner, Prix, prix louis delluc, qu'un seul tienne et les autres suivront, un prophete.
Publié dans Films, Prix |
Posté par Benjamin, le 10 décembre 2009
 Arrivés le mardi 8 décembre, Claire Burger et Nassim Amaouche, membres du jury et jeunes cinéastes français, connaissent bien les Rencontres Henri Langlois pour y avoir participé et reçu des prix. Tout deux ont en effet été récompensés par le Prix spécial du jury (en 2004 pour Nassim et en 2008 pour Claire) et ils étaient également au dernier festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Le court métrage de Claire précédait la projection du long de Nassim. Après une rencontre avec des lycéens et des étudiants en cinéma, ils ont bien voulu nous accorder un petit moment en totale décontraction et autour d'une tasse de café...
Arrivés le mardi 8 décembre, Claire Burger et Nassim Amaouche, membres du jury et jeunes cinéastes français, connaissent bien les Rencontres Henri Langlois pour y avoir participé et reçu des prix. Tout deux ont en effet été récompensés par le Prix spécial du jury (en 2004 pour Nassim et en 2008 pour Claire) et ils étaient également au dernier festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Le court métrage de Claire précédait la projection du long de Nassim. Après une rencontre avec des lycéens et des étudiants en cinéma, ils ont bien voulu nous accorder un petit moment en totale décontraction et autour d'une tasse de café...
Regard sur les festivals.
Le ton est amical, les blagues circulent (surtout de la part de Nassim Amaouche) mais cela n'empêche pas le propos d'être sérieux. Et même s'ils sont encore de jeunes cinéastes, Claire et Nassim ont l'expérience des festivals et s'expriment sur ce type de manifestation. Sans parler des Rencontres Henri Langlois dans un premier temps, ils abordent leur présence dans de nombreux festivals. Tout deux insistent par exemple sur le fait que si un festival est un lieu d'échange, un réalisateur ne doit pas y passer sa vie: "notre métier c'est de faire du cinéma [...] On se perd à aller dans tous les festivals" confie Claire Burger. Non pas qu'ils n'apprécient pas d'y être conviés, bien au contraire, mais c'est parfois une tentation à éviter pour eux s'ils veulent garder leur concentration intacte.
Cependant, Nassim Amaouche déclare avoir "besoin des festivals" car "quand on fait des courts métranges, [c'est] le seul endroit où on peut les montrer" et que "gagner un prix, ça fait de l'argent". Il est vrai que pour des jeunes cinéastes qui débutent, les festivals sont l'occasion de pouvoir partager et discuter de leur oeuvre, notamment avec des professionnels et donc d'avoir l'opportunité de faire des rencontres qui peuvent leur être bénéfique pour l'avenir. Toutefois, le réalisateur d'Adieu Gary tient à rappeler (c'est son côté "engagé" qui s'exprime) que les festivals de courts métrages souffrent ces derniers temps. Des festivals "militant qui croient à l'éducation par l'image" mis à mal par le gourvenement (il cite celui de Clermont-Ferrand qui a eu des déboires avec le ministre Brice Hortefeux): "on a fait passer des équipes qui organisaient [des] festivals plus ou moins ambitieux pour des exploitants de bénévols. On est dans une période de résistance en terme de culture".
En acceptant d'être jurés pour les Rencontres Henri Langlois, Claire et Nassim ont exprimé leur envie "d'aider" ces petits festivals et ce cinéma discret. De rendre, quelque part, ce que ces derniers leur avaient offert.
Les Rencontres Henri Langlois.
Les deux réalisateurs nous font part de leur joie, de leur plaisir d'être à Poitiers. Pour des raisons personnelles (Nassim Amaouche y a par exemple rencontré sa femme) mais aussi pour des raisons plus professionnelles, parce que Poitiers est un festival plus ouvert au public que d'autres, plus axé sur l'échange et le partage. Un festival véritablement vivant qui apporte "des rencontres qui encouragent" déclare Claire Burger, et qui "contrairement à d'autres festivals, nous propose de rencontrer des scolaires, d'aller montrer les films en prison, de rencontrer différents types de publics".
Il est vrai que le festival de Poitiers met 'accent sur cette participation des plus jeunes qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants voire maternelles (puisqu'un programme, Piou-piou, a été mis en place spécialement pour eux). Des jeunes à qui il est permis d'aller vers un autre cinéma (d'auteur, asiatique) et de rencontrer des cinéastes (tels que Rithy Panh) qui leur offrent de véritables leçons de cinéma. C'est sans doute ce savant mélange entre professionnalisme et amateurisme qui les charme tant.
Il ne leur reste plus désormais qu'à juger (une mission qu'ils prennent à la fois avec sérieux et détachement) les 40 films en compétition pour rendre leur palmarès samedi à 18h30. Un palmarès qu'ils disent déjà subjectif et très modeste...
Tags liés à cet article: claire burger, festival, interview, jury, nassim amaouche, Poitiers, rencontres internationales Henri Langlois.
Publié dans Festivals, Personnalités, célébrités, stars, Poitiers |
Posté par vincy, le 10 décembre 2009
Johnny Depp renoue avec le cinéma d'auteur européen. Hormis la version inachevée de Don Quichotte par Terry Gilliam, la star américaine s'était souvent fourvoyée dans des productions insipides hollwoodiennes ces dernières années, entre deux épisodes de la franchise qui l'a rendu milliardaire, Pirates des Caraïbes, et les films de Tim Burton. Cette année, avec les films de Terry Gilliam et Michael Mann, Depp a retrouvé son public cinéphile. Et ça devrait continuer puisque l'acteur a accepté d'être le révolutionnaire mexicain Pancho Villa dans le prochain film d'Emir Kusturica.
17 ans après Arizona Dream (Prix spécial du jury à Berlin), les deux artistes croisent de nouveau leur chemin. Depp est devenu une star mondiale catégorie A, Kusturica a été confirmé comme un cinéaste majeur avec une deuxième Palme d'or. Le réalisateur Serbe n'a cependant pas convaincu les critiques depuis plusieurs années, sans doute enfermé dans son style, ou désireux de liberté (documentaire, tournée musicale...).
L'actrice mexicaine (productrice hollywoodienne, épouse d'un milliardaire français) Salma Hayek complète le casting de ce film qui sera tourné cet hiver en Andalousie (Espagne).
Kusturica adapte ici le livre de James Carlos Blake, Les amis de Pancho Villa, racontant l'histoire du bandit et général mexicain "à travers les yeux de ses amis et de la femme qu'il aimait".
A l'origine, Kusturica avait songé à Javier Bardem pour le rôle de Villa.
Tags liés à cet article: adaptation, emir kusturica, javier bardem, johnny depp, les amis de pancho villa, pancho villa, projet, salma hayek, terry gilliam.
Publié dans Films, Personnalités, célébrités, stars, Projet, tournage |
Posté par Benjamin, le 9 décembre 2009
 Les 32ème Rencontres Henri Langlois ont débuté depuis maintenant plusieurs jours et les films en compétition s'enchaînent, pour le plaisir des festivaliers, jeune en majorité !
Les 32ème Rencontres Henri Langlois ont débuté depuis maintenant plusieurs jours et les films en compétition s'enchaînent, pour le plaisir des festivaliers, jeune en majorité !
A retenir de cette journée du 7 décembre, deux films allemands: l'un de Christiane Lilge, Schwester Ines (Infirmière Inès) et l'autre de Lars-Gunnar Lotz, Für Miriam (Pour Miriam). Deux films qui ont dans leur titre des prénoms de femme. Ce n'est bien entendu par anodin puisque tout deux ont pour personnages principaux des femmes (Inès et Karen). Deux femmes dont les corps vont être mis à mal, dont le corps se fait le reflet de leurs souffrances intérieures.
Un peu à la façon de Cronenberg (mais en forçant beaucoup le trait), l'expression des sentiments passe par une certaine martyrisation du corps. Le mal-être des personnages, retenu, contenu, s'exprime avec violence sur leurs corps. Dans Schwester Ines, c'est le corps maternel qui est mis en avant. Inès est une jeune infirmière, une sage-femme qui travaille dans un institut qui met tout en oeuvre pour que l'accouchement des futurs mamans se déroule dans les meilleurs conditions. Mais Inès, qui n'a jamais quitté son lieu de travail, souhaite découvrir le monde extérieur. Une coupure, une rupture qui est impossible car sa mère l'en empêche. Et cet empêchement se traduit de façon physique et horrifique. Par d'impressionants jeux visuels, le jeune réalisateur fait se refermer sur Inès l'appareil génital de sa mère (elle se retrouve emprisonnée dans le ventre maternel). En parallèle, une femme enceinte depuis 13 mois refuse d'accoucher. Par le physique, par le rapport au corps s'exprime la lutte entre l'enfant et la mère. Une mère qui trône comme figure unique puisque le père n'est pas accepté dans l'institut. Et le film repose sur ce combat d'Inès et du bébé pour "sortir" et se libérer de l'étreinte de la mère. Se libérer pour découvrir et appréhender seul le monde extérieur.
Pour ce qui est de Für Miriam, le film est plus long (57 min contre 27 min pour le premier) et l'histoire plus élaborée, plus posée. L'histoire d'une professeur de mathématiques, Karen, qui, par accident, tue en voiture la jeune soeur d'un de ses élèves. A partir de là et de ce traumatisme, une relation tendue s'instaure entre l'élève et le professeur. Karen tente à tout prix de se faire pardonner et se soumet alors au jeune homme qui libère sur elle ses pulsions, qu'elles soient violentes (par des coups) ou sexuelles. Les deux êtres finissant par se "lier" physiquement l'un à l'autre comme pour communier dans leur douleur partagée. C'est là encore le corps qui est le réceptacle des émotions, des souffrances qui déchirent et qu'on ne parvient à exprimer.
Un film coup de coeur qui brille par la performance de ses acteurs et par le soin apportée à l'histoire, ce qui manque un peu aux autres films.
Tags liés à cet article: christiane lilge, cinéma allemand, festival, fur miriam, lars gunnar lotz, Poitiers, rencontres henri langlois, schwester ines.
Publié dans Critiques, Festivals, Films, Poitiers |
 China Moses, Liane Foly, Anthony Kavanagh prêtent leur voix au nouveaufilm d'animation de Disney, La Princesse et la Grenouille. Le film vient de sortir aux Etats-Unis, où, avec 27 millions de $ de recettes, il domine le box office du week-end.
China Moses, Liane Foly, Anthony Kavanagh prêtent leur voix au nouveaufilm d'animation de Disney, La Princesse et la Grenouille. Le film vient de sortir aux Etats-Unis, où, avec 27 millions de $ de recettes, il domine le box office du week-end.


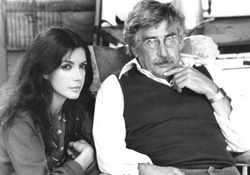
 Il est en quelque sorte l'invité d'honneur de ces 32ème Rencontres Henri Langlois qui cette année présente un focus sur l'Asie du sud-est. Rithy Panh (réalisateur dernièrement d'
Il est en quelque sorte l'invité d'honneur de ces 32ème Rencontres Henri Langlois qui cette année présente un focus sur l'Asie du sud-est. Rithy Panh (réalisateur dernièrement d'
 Arrivés le mardi 8 décembre, Claire Burger et Nassim Amaouche, membres du jury et jeunes cinéastes français, connaissent bien les Rencontres Henri Langlois pour y avoir participé et reçu des prix. Tout deux ont en effet été récompensés par le Prix spécial du jury (en 2004 pour Nassim et en 2008 pour Claire) et ils étaient également au dernier festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Le court métrage de Claire précédait la projection du long de Nassim. Après une rencontre avec des lycéens et des étudiants en cinéma, ils ont bien voulu nous accorder un petit moment en totale décontraction et autour d'une tasse de café...
Arrivés le mardi 8 décembre, Claire Burger et Nassim Amaouche, membres du jury et jeunes cinéastes français, connaissent bien les Rencontres Henri Langlois pour y avoir participé et reçu des prix. Tout deux ont en effet été récompensés par le Prix spécial du jury (en 2004 pour Nassim et en 2008 pour Claire) et ils étaient également au dernier festival de Cannes à la Semaine de la Critique. Le court métrage de Claire précédait la projection du long de Nassim. Après une rencontre avec des lycéens et des étudiants en cinéma, ils ont bien voulu nous accorder un petit moment en totale décontraction et autour d'une tasse de café... Les 32ème
Les 32ème 

 Flux rss
Flux rss

