Héritière directe de ceux qui voulaient affranchir le cinéma de ses chaînes en 1968, la Quinzaine célèbre cette année sa 50e édition. L'occasion d'une promenade à son image - en toute liberté, et forcément subjective - dans une histoire chargée de découvertes, d'audaces, d’enthousiasmes, de coups de maîtres et de films devenus incontournables.
En partenariat avec Critique-Film. Retrouvez tout le dossier ici.

La Quinzaine des réalisateurs, grande prêtresse du cinéma indépendant, du cinéma contestataire, du cinéma underground, moderne, ouvert, libre. La Quinzaine faite par le monde, pour le monde. Une révolte contre l’élitisme cannois, contre la censure systématisée, et contre toute forme d’institutionnalisation. C’est en cessant de cacher ces films qu’on ne saurait voir que nos agitateurs vont ouvrir la porte, jusque-là verrouillée, d’un cinéma nu et sincère. Le 10 mai 1968 s’ouvre le 21e Festival de Cannes. Et c’est en 69, année érotique, qu’on assiste à la naissance d’un immense Fes[se]tival. La première édition de la Quinzaine a le [cul]ot de projeter Le Joujou chéri de Gabriel Axel.

Film documentaire et long-métrage de fiction s’entremêlent dans cette audacieuse production danoise. Le Joujou chéri traite de la production de magazines et de films érotiques et dénonce une censure bien trop présente (surtout en France !). On découvre en une heure et demie la diversité de l’érotisme sur grand écran, du cinéma moderne au cinéma muet. Gabriel Axel réalise ce premier documentaire sans salaire, et sans réel financement. Fort d’une envie de transgression et de liberté, Axel nous interroge sur la présence de l’érotisme dans l’art. Pourquoi un artiste peintre, proposant un nu, offre de l’Art au spectateur, tandis qu’un photographe (ou un cinéaste) représentant un même nu est classé immédiatement comme pornographe ? Ce message passe directement par l’affiche du film : une gravure libertine. Art, ou pornographie ?
Par son interdiction, la pornographie se fait sombre, glauque, étouffante. Gabriel Axel, lui, veut présenter un univers lumineux, léger, joyeux, et bon enfant. A force d’interdire et de censurer, l’impression que le sexe est un danger pour l’homme se fait de plus en plus forte. Mais où est le danger ?
C’est grâce à un Danemark bien plus libéral que la France que Le Joujou chéri passe la frontière. Rappelons d’ailleurs que cette œuvre aidera à supprimer la censure adulte en 1969 dans son pays. Malgré cette hardiesse, le film sera interdit en France et ne sera distribué en province qu’en 1974 via un circuit allemand, sous le nom de Das Geliekte Spielzub. Le Joujou chéri passera ici d’une heure et demie, à une heure et quart.

Tandis que la demande de suppression de la censure de la part des Etats Généraux du Cinéma suit son cours, deux nouvelles œuvres culottées s’emparent de la Quinzaine : Le Hurlement de Tinto Brass en 1970, et Mais ne nous Délivrez pas du mal de Joël Séria en 1971.
Le Hurlement est un cri de joie et de colère, une folie douce parfaitement représentative de l’air du temps. Film psychédélique soixantehuitard, L’Urlo explore une société changeante. Les repères sont flous, la jeunesse ne sait plus à quoi se raccrocher, et erre au travers d’un milieu hostile et incompréhensible tout comme Anita (Tina Aumont) et son amant Coso (Gigi Proietti) principaux protagonistes. Anita, activiste de gauche, fuit son fiancé et rencontre un parfait inconnu avec qui elle va voyager dans une Italie étrange et grotesque, rencontrant tour à tour une famille de cannibales et des fanatiques explorant différentes facettes de leur sexualité. Le message est clair : c’est en quittant les conventions que l’individu explore et nourrit son être intérieur.
Tinto Brass, auteur, scénariste et monteur, abandonne ici les traditions narratives et invite le spectateur à vivre son œuvre comme une expérience sensorielle. Il ne raconte pas mais dénonce la condition tragique de l’homme moderne seul face à la misère, à la mort, et à l’esclavagisme de la société, en continuant ainsi son travail amorcé en 1964 avec Who Works ?. Contrairement à Who Works ?, L’Urlo sera interdit par la censure en Italie pendant pas moins de sept ans.
Bizarre, surréaliste, et radicalement ancré dans la contre-culture, Le Hurlement reste tout de même proche de réalisations dans la même veine, aussi bien au niveau du scénario, qu’au niveau de la réalisation. On y retrouve des couleurs similaires, des scènes en extérieur peu surprenantes, et une révolte politique qu’on croise de partout.

Tandis qu’en 1971, Mais ne nous Délivrez pas du mal fera l’effet d’une bombe parmi les festivaliers cannois. « Une œuvres des plus malsaine […] en raison de la perversion, du sadisme et des ferments de destruction morale et mentale … » ainsi parlait la Commission de contrôle du premier long-métrage de Joël Séria.
Elevé dans un foyer à l’éducation religieuse stricte, et éduqué en pensionnat chez les curés pendant une dizaine d’années notre réalisateur est frappé par l’image idyllique d’une jeune fille qui inspirera l’aspect de ses deux héroïnes. Cette image est celle croisée au hasard d’un article de journal, celle d’une petite nymphette aux joues pleines et aux boucles rondes. Une petite fille modèle ayant décidé de jouer à la poupée avec sa meilleure amie. La poupée sera sa mère, le jeu : la lapidation. Fait divers néo-zélandais, cette histoire nourrira celle de Mais ne nous Délivrez pas du mal dans une certaine mesure. C’est d’ailleurs de ce film et de cet article que Peter Jackson tirera Créatures Célestes en 1994.
Ce long-métrage sera tourné sans l’accord du CNC, mais Joël Séria persiste. Ce scénario est ancré en lui, et il se doit de le coucher sur pellicule. Il réalise cet exercice avec brio et nous dévoile ses talents de poète. On retrouve dans ce film une mélancolie toute baudelairienne, mêlée à l’insouciance de la jeunesse et aux secrets de l’adolescence. Nos deux Lolitas, Anne et Laure, sont deux petites filles modèles en apparence mais, et ce dès les premières scènes, il se dégage d’elles une sainteté diabolique. Tout comme Joël Séria, elles se voient dès leur plus jeune âge cloîtrées chez les bonnes sœurs avec, pour seule distraction, leur imagination viciée et leurs loisirs sadiques. Anne et Laure se complaisent dans le mal comme d’autres se complaisent dans le bien ; elles œuvrent pour Satan en âme et conscience, en opposition à tout ce qui leur a été inculqué. Mais ne nous Délivrez pas du mal est un film fort, puissant, et étrangement doux. L’apparence bucolique de la campagne contraste avec la perversion des actes de nos héroïnes et nous rappelle curieusement nos propres étés. La torpeur estivale, les nuits fraiches, les balades à vélo donnent une sensualité prématurée à Anne et Laure qui se dénudent à toutes occasions.
Le scénario, puissamment anticléricale et légèrement éphèbiphile, fera interdire le film malgré sa présence à la Quinzaine. Ce n’est qu’après la coupe de quelques secondes d’une scène lesbienne entre religieuses que le film sera accessible au public. Joël Séria, sera alors l’un des derniers réalisateurs de long-métrage à avoir un film bloqué. Bien plus qu’une œuvre profane, Mais ne nous Délivrez pas du mal est une mise en garde contre le refoulement, la pression et l’oppression chez les adolescents. Autre sujet fort du début des années 70.
« 1973, on interdit. 1974, on libéralise. Avant de réprimer en 1975 puis de punir en 1976 »
(Entre deux censures, 1989, Tony Crawley et François Jouffa)
Le 28 avril 1974, Valérie Giscard d’Estaing, fraîchement élu président de la république, annonce la suppression de la censure en France et prône la liberté d’expression et de création. Cette décision révolutionnera le paysage cinématographique tout entier. A la capitale, en banlieue et en province, les cinémas affichent impudiquement des œuvres érotiques sur leurs façades et dans leurs halls. En une année, plus de 128 films voluptueux sortent en salle : Les Jouisseuses, Emmanuelle, et La Papesse (pour n’en citer que quelques-uns) embrasent les foules qui se précipitent pour voir le tabou en scope. Cette curiosité légère poussera 6 497 687 parisiens et banlieusards à se cloîtrer dans les pièces confinées, surchauffées et électrisées des exploitants de 74. Le secrétaire d’état, Michel Guy, dans un éclat de lucidité, ou dans un moment de faiblesse, autorisera même l’exploitation des films pornographiques !

Ce vent de liberté atteindra rapidement la croisette qui présentera à sa sélection officielle les sulfureuses Mille et une nuits de Pier Paolo Pasolini et les outrancière Neuf vies de Fritz le chat de Robert Taylor. La Quinzaine, quant à elle, ira chercher du côté de la Yougoslavie pour trouver LE réalisateur adéquat pour cette année toute en fesses : Dusan Makavejev, auteur et scénariste de Sweet Movie.
Carole Laure (Miss Canada) porte plainte contre Makavejev, Anna Prucnal (Anna Planeta) est exilée de Pologne pendant sept ans, le film est banni en Grande-Bretagne et, en France, il subit l’interdiction aux mineurs de moins de 18 ans. Tout ça pour quoi ? Pour un film-manifeste, une œuvre forte qui malgré elle a engendré un scandale plus grand que ce qu’elle envisageait. Pour un poème érotico-politique ou le socialisme et le capitalisme se contemplent d’un œil curieux et cherchent à s’apprivoiser. Contrairement aux autres films de Dusan Makavejev, Sweet Movie nous offre une confrontation sociale plus directe, sans soliloques gouvernementaux indigestes. Il cherche ici à établir une relation sensorielle écran-spectateur. La sensualité est la grande ligne directrice de la mise en scène et du scénario, toute la cohésion de l’équipe de tournage vise à prôner la joie de vivre, l’amour universel et la connaissance de soi par le biais du sexe. Makavejev fait tomber les masques de l’auto-censure, le spectateur est mis à nu, sa carapace se fend et fond face à l’humour chaleureux et à la moiteur sexuelle de Sweet Movie. On parle ici « d’effet thérapeutique » comme un « aphrodisiaque léger », une communication non-verbale poussant le public à s’observer, se sentir, se toucher, se goûter, et se découvrir à travers l’œuvre.
Soulignons le fait que Makavajev, culpabilisant de ce trop-plein de bonheur face à la misère du monde, inséra dans le film des séquences documentaires sur l’excavation de cadavres polonais par des officiers nazis. Triste monde cruel.

Nous finirons l’année, le 17 octobre 1974, par une suppression du fond de soutien pour les films pornos … Monsieur Giscard et Monsieur Guy seraient-ils en train de revenir sur leurs convictions ?
En 1976, les bonnes résolutions de nos deux compères sont mises au placard. Pornographie ? Erotisme dites-vous ? Du passé. La loi X s’impose insidieusement, feignant l’absence de censure et affichant une simple restriction. La TVA sur les films dit pornos passe de 17.6% à 33.33%, 161 films sont classés X et interdit d’exploitation … Les rares œuvres encore en circuit sont reléguées dans des salles spécialisées pénalisées fiscalement et financièrement. Si ça ce n’est pas de la censure …
Mais la Quinzaine résiste encore et toujours à la restriction, à l’enclavement, et au blâme, et elle le montre plus que jamais avec L’Empire des sens de Nagisa Oshima. Toute la France est ébranlée, le phénomène est sans précédent. De plus, L’Empire des sens n’est pas noyé dans la sélection, loin de là, il est le film d’ouverture de cette nouvelle programmation, l’œuvre mise en lumière, l’œuvre sous les projecteurs du public, de la critique, des journalistes, et de l’organisation.
Nous ne nous étendrons pas plus que nécessaire sur ce film qui a déjà fait couler beaucoup d’encre (et beaucoup d’autres liqueurs plus naturelles). Rappelons juste que celui-ci est un pied de nez aux tabous japonais. Nagisa Oshima c’est procurer une pellicule vierge française, l’a fécondé sur sa terre natale, et l’a renvoyé en France pour la mise à bas. L’Empire des sens est interdit au Japon, rn Allemagne, en Suède, aux Etats-Unis, en Belgique … Mais la Quinzaine relève le défi de présenter cette œuvre, et tente d’ouvrir le regard du public non pas sur un film érotique ou pornographique, mais sur un poème visuel digne des estampes japonaises. Tout ici est d’une minutie implacable, la mise en scène est épurée, les dialogues finement orchestrés, et les couleurs éclatantes renforcent le lyrisme de ce qui n’était à l’origine qu’un fait divers.
L’Empire des sens établi un seul et même discours : celui d’une scène d’amour en continu, le cadre change mais l’acte reste. Même si le sexe n’est pas simulé, même si la scène finale est d’une violence inouïe, le film reste immaculé grâce à sa perfection visuelle, et grâce à ce discours n’étant ni plus ni moins qu’une approbation de la vie jusque dans la mort, l’amour ultime et inconditionnel.
Les œuvres vue précédemment sont politiques, sociales, révoltées. Elle utilise la représentation du sexe pour faire passer des messages plus ou moins abstraits, mais elles négligent l’amour rencontré dans la relation sexuelle. Nagisa Oshima, lui, le sublime.
Mais si la politique vous manque rappelons que, en 1988, interviewé par Bernard Pivot, Jacques Chirac confessera : « J’ai vu L’Empire des sens dans la salle d’un cinéma privé qui appartient au ministère de l’information. J’ai estimé que c’était un très beau film … »
Merci au ministère de l’information et merci à Jacques !

La Quinzaine nous réservera d’autres belles surprises telles que la coréalisation franco-japonaise des Fruits de la passion de Shuji Terayama en 1981, adaptation très libre de Retour à Roissy de Pauline Réage. L’adaptation encore plus libre en 1986 du Diable au corps de Marco Bellocchio et sa vraie fellation qui coûtera cher à la carrière de Maruschka. L’onirique, le lyrique, le diaphane Kissed, premier film de Lynne Stopkewich, fable nécrophile tirée d’une nouvelle de Barbara Gowdy. Et le très contemporain Année Bissextile de Michael Rowe explorant la mécanique d’un couple sadomasochiste.
Puis d'autres films oubliés : La Fille offerte d’ Helma Sanders-Brahms, Irezumi - Esprit de tatouage de Yoichi Takabayashi, L’Esquimaude a froid de Janos Xantus, Annabelle Partagée de Francesca Comencini …
Tant de films autour d’un seul et même sujet, d’une problématique ancestrale qui semble régir le monde : le sexe. Le sexe politique, le sexe social, le sexe spirituel, les sexes, les sexualités. Parfois représenté avec pudeur, parfois avec exubérance, le sexe est mis à l’honneur dans ces œuvres qui ont su le magnifier avec respect.
La sexualité, même surreprésentée, reste encore tabou. Une petite partie de chacun d’entre nous dort dans une coquille de glace. Le rôle de ces films est, entre autre, de faire fondre cette armure pour que le spectateur découvre avec émotion une autre facette de sa personnalité, belle, pure, et lumineuse.
La Quinzaine est le réceptacle d’une sensualité venue du monde entier. Elle livre au sein de l’une des plus grandes institutions cinématographiques un havre de chaleur cotonneuse. Elle ne nie pas ce qui fait un pan tout entier de l’Homme, elle l’embrasse, elle se l’approprie, avec une programmation toujours précise et surprenante. La Quinzaine réinvente le sexe sur grand écran et le crédibilise.
Clara Sebastiao de critique-film










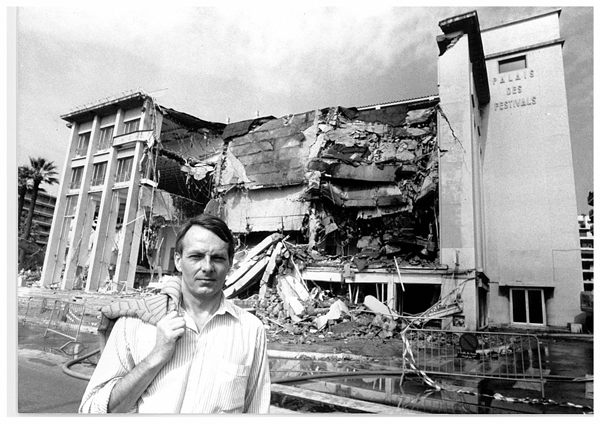














 Flux rss
Flux rss

