
Juliette Binoche et Yves Montand sur le Mur de Berlin © vincy thomas
50 ans d'amitié franco-allemande et après? Les Français ne parlent pas plus allemand. Même s'ils aiment aller faire la fête à Berlin, boire de la bière à Munich, se laisser charmer par les villes rhénanes, admirer le dynamisme d'Hambourg... On lit parfois des auteurs allemands, une élite culturelle vénère danseurs, metteurs en scène et opéras des voisins de l'Est, on écoute rarement de la pop ou du rock germanique, et il n'y a bien que les quelques centaines de milliers de téléspectateurs d'ARTE qui regardent des programmes bilingues. L'Allemagne c'est quoi finalement pour un Français? La rigide chancelière, des marques de voiture, Hugo Boss, éventuellement la coopération aéronautique, des supermarchés low-cost, des Kinders avec un cadeau à l'intérieur, les immuables Playmobil, Adidas, de la colle Uhu, de la crème Nivea, des appareils Siemens...
Et le cinéma? Il est de plus en plus "absent". En France, le cinéma allemand est vu de la même manière que le cinéma belge, italien ou scandinave. Les cinéphiles français sont plus proches des cinémas espagnols et anglais. Ça n'a pas toujours été comme ça mais c'est ainsi. Il est loin le temps où Jules et Jim, L'As des As, La Grande vadrouille valorisaient les liens renoués entre les deux pays, tout en cartonnant au box office des deux côtés du Rhin.
Ce lien est aujourd'hui invisible, et financier. Le nombre de coproductions entre les deux pays a considérablement augmenté depuis le début des années 2000, donnant des Palmes d'or comme Le Pianiste, Le Ruban blanc ou le récent Amour, ou des triomphes populaires comme Astérix. Là encore, la création d'ARTE n'y est pas pour rien. La chaîne reverse une partie de son budget annuel (3,5%) pour coproduire des films européens (Lars von Trier entre autres). Des centaines de films de plusieurs dizaines de nationalités ont ainsi profité de ce financement, propulsant la chaîne dans les génériques de films sélectionnés dans les plus grands festivals de cinéma du monde.
 Quelques succès cachent le fossé
Quelques succès cachent le fossé
Mais. Il y a 30 ans, les cinéphiles couraient voir les films de Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff et Wim Wenders. Ils ont influencé des générations de cinéastes, à l'instar de François Ozon. Aujourd'hui, aucun cinéaste allemand n'a leur notoriété, ou même celle d'un Kaurismaki, d'un Moretti, d'un Almodovar, d'un Verhoeven, d'un Von Trier, ou encore d'un Ceylan (considérant que la Turquie est en partie européenne). Et que dire des stars allemandes? Spontanément on cite qui? Où sont les Dietrich ou les Schneider d'antan? Bien sûr, il y a des succès. Et pas des moindres : La Vie des autres (Florian Henckel von Donnersmarck, 1,4 million d'entrées), Good Bye Lenin (Wolfgang Becker, 1,2 million d'entrées), Le Parfum (Tom Tykwer, 925 000 entrées) ou La Chute (Oliver Hirschbiegel, 795 000 entrées).
Mais plus généralement, un film allemand, quand il trouve son public, ne dépasse pas les 350 000 spectateurs, que ce soit Pina de Wim Wenders, La grotte des rêves perdus de Werner Herzog, Soul Kitchen ou en 2012 Barbara (225 000 entrées). A peine dix films allemands ont bénéficié d'une couverture médiatique minimale (critiques dans la presse écrite, chroniques à la radio, campagne d'affichage...). Il faut avoir reçu des prix internationaux (Barbara) ou profité du nom du cinéaste (Into the Abyss de Werner Herzog) pour obtenir davantage (interview d'un cinéaste, portrait d'un comédien). La télévision reste à l'écart, et ne participe pas à un quelconque essor.
Une relation déséquilibrée même dans les grands festivals
En fait, la relation bilatérale entre les deux cinématographies est plus que bancale. Si le Festival de Berlin met en compétition de nombreux films Français (jusqu'à les primer : 2 Ours d'or en 20 ans, 3 prix de mise en scène, 3 prix d'interprétation, 4 Ours d'or d'honneur...), le Festival de Cannes est souvent critiqué par les professionnels allemands pour ignorer le cinéma germanique dans sa compétition. La dernière Palme d'or remonte à 1984, le dernier Grand prix du jury à 1993, le dernier prix de la mise en scène à 1987, le dernier prix d'interprétation féminine à 1986, et aucun acteur n'a jamais été récompensé... Wenders est le dernier cinéaste a avoir été retenu en compétition, en 2008. Fatih Akin, sans doute le réalisateur allemand le plus passionnant de ce début de millénaire, est le dernier à avoir été récompensé, par un prix du scénario pour De l'autre côté. On note cependant quelques pépites dans les autres sélections (Pour lui, meilleur film allemand 2011, à Un certain regard). A Venise, la tendance est la même qu'à Cannes. En France, les César n'ont donné qu'un seul prix (La vie des autres) pour trois nominations (De l'autre côté, la même année, et Good Bye Lenin!) dans le même laps de temps.
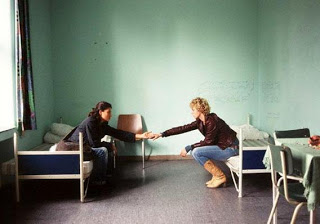 Côté box office, on constate le même déséquilibre. Intouchables attire 8,5 millions de spectateurs dans les salles allemandes. The Artist, Et si on vivait tous ensemble et le troisième Astérix se classent dans le Top 100 de 2012. Aucun film allemand ne parvient à réussir cet exploit en France.
Côté box office, on constate le même déséquilibre. Intouchables attire 8,5 millions de spectateurs dans les salles allemandes. The Artist, Et si on vivait tous ensemble et le troisième Astérix se classent dans le Top 100 de 2012. Aucun film allemand ne parvient à réussir cet exploit en France.
Et que dire des succès allemands que l'on ne verra jamais en France comme Türkisch für Anfänger (12e du BO annuel), Mann tut was Mann kann ou même la version cinéma du Club des Cinq?
Comme si le Rhin était un fossé infranchissable dans un sens, mais pas dans l'autre. Cependant le cinéma allemand est aussi responsable de ses propres maux. La part de marché locale ne dépasse par les 25% (et sera même beaucoup plus faible en 2012) là où le cinéma français séduit 35 à 40% des spectateurs français. En 2011, un seul film allemand (Kokowääh) était classé dans les 20 films européens les plus vus en Europe. On est loin du record de 2009 (avec trois films, même si aucun d'eux n'a été réellement exporté hors pays germanophones). Même les films récompensés aux German Film Awards ne sortent pas dans les salles françaises.
Un cinéma marginalisé même dans un pays cinéphile
Pourtant il existe le cinéma allemand : cinq réalisateurs germaniques ont été nommés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère depuis 2000 (et deux ont gagné). Le dernier grand événement lié au cinéma allemand fut la rétrospective Fritz Lang et l'exposition Metropolis à la Cinémathèque française. On pourrait alors se demander si le cinéma allemand a intérêt à se concentrer sur le rendez-vous de la Berlinale chaque année, en se coupant des autres festivals... Le nombre de productions respectables est peut-être trop faible pour jouer toute son année en un seul rendez-vous...
Alors, où est le problème? Une nostalgie d'un cinéma autrefois glorieux et audacieux et aujourd'hui banalisé par l'invasion de cinématographies de pays comme l'Argentine, la Corée du sud ou la Roumanie? Une absence de cinéphilie experte permettant de valoriser ce cinéma en France? Un problème allemand, politique et culturel, qui ne permet pas de promouvoir son cinéma à l'extérieur de ses frontières? Ou, plus concrètement, la fragilité d'un cinéma d'auteur allemand? Un peu de tout ça sans doute. Auquel on ajoute une carence de vision européenne du 7e art de la part des institutions : le cinéma reste un domaine national quand il s'agit de création. Seuls les capitaux sont transfrontraliers. Ainsi Haneke, autrichien, est coproduit par la France et l'Allemagne, tout comme Polanski franco-polonais, qui vient tourner à Berlin, etc... La mondialisation est partout, sauf dans les sujets, dans les projets.
Des initiatives institutionnelles et professionnelles, coupées du public
Face à cette impuissance à copuler ensemble, le cinéma allemand et le cinéma français essaye d'initier des collaborations "en amont" et "en aval". L’Académie franco-allemande du cinéma a été initiée en 2000 par le chancelier allemand Schröder et le président français Jacques Chirac pour favoriser la collaboration entre ces deux pays en matière de cinéma. Sous la tutelle du Centre National de la Cinématographie et de l'Image animée (CNC) et du Beauftragter für Kultur und Medien (BKM), elle a pour objectif de contribuer à la construction de l’Europe du cinéma, en renforçant la collaboration entre la France et l’Allemagne dans quatre secteurs : la production, la distribution, la formation et le patrimoine.
Par ailleurs, le CNC et la Filmförderungsanstalt (FFA) ont mis en place un fonds dans lequel chaque pays contribue à hauteur de 1,5 millions d’euros. Ce fonds, appelé également mini-traité, permet aux producteurs d’accéder à des aides pour la coproduction franco-allemande.
Dans le cadre de cette Académie, une formation commune dans les secteurs de la production et de la distribution de films a été créée en 2001 entre La Fémis et l’école de cinéma à Ludwigsburg.
Enfin, en 2003, Les rendez-vous franco-allemands du cinéma permettent d’harmoniser les deux systèmes de production pour faciliter les coproductions et d’encourager la distribution des films allemands en France et des films français en Allemagne. Ils ont lieu chaque année, alternativement en France et en Allemagne, sous le parrainage d'Unifrance et German Films.
Il y a aussi Les Journées du film français à Stuttgart et Le Festival du cinéma allemand à Paris. Mais il faudra bien plus pour que le pont entre les deux pays, les deux cinématographies, soit consolidé. Des films qui font le lien comme Joyeux Noël par exemple. C'est d'autant plus important que le cinéma, culture de masse par excellence, est un outil de divertissement idéal pour mieux comprendre son voisin, abattre les préjugés et apprendre à connaître la culture et la société de cet ami de 50 ans. Il faut en finir avec l'idée que l'Allemagne c'est Derrick. Comme la France est parvenue à remplacer Louis de Funès par Omar Sy.





 Quelques succès cachent le fossé
Quelques succès cachent le fossé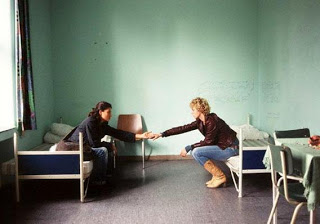


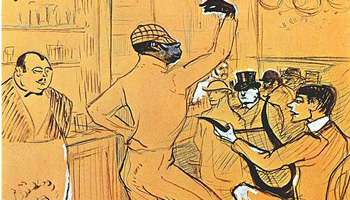


 Flux rss
Flux rss

