Posté par MpM, le 15 mars 2011
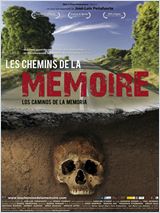 "Nier l'Histoire, c'est risquer de la répéter."
"Nier l'Histoire, c'est risquer de la répéter."
L'histoire : Plus de trente ans après la mort de Franco, José-Luis Penafuerte interroge la mémoire collective espagnole. Il filme l'excavation des fosses de la guerre civile, recueille le témoignage d'exilés politiques et de descendants des disparus et prête même l'oreille aux élucubrations des derniers franquistes.
Notre avis : Voilà un documentaire salutaire, indispensable et surtout captivant qui n'hésite pas à relever les contradictions d'un pays qui ne s'est jamais remis de son Histoire. En effet, plus de soixante-dix ans ont passé depuis la guerre civile, et pourtant, en Espagne, le sujet reste extrêmement sensible. Alors que certaines familles sont toujours à la recherche de leurs disparus, nombreuses sont celles qui, au contraire, voudraient enterrer le passé. Sans parler des illuminés qui n'hésitent pas à le glorifier (le film montre un rassemblement de nostalgiques de l'époque franquiste). Comme si, dans les esprits, la guerre se poursuivait encore et encore, sur un plan moral, émotionnel, intime, entre ceux qui se vantent toujours d'appartenir au camp des vainqueurs, et ceux qui veulent simplement faire (re)connaître la vérité.
Si cet épisode de l'histoire est toujours aussi douloureux, c'est bien sûr parce qu'il fut terrible (60 000 exécutions, 130 000 disparus, 300 000 dénonciations, 400 000 prisonniers...) et que bien des victimes ne purent jamais faire leur deuil, mais sans doute aussi parce que la culpabilité ronge encore une partie de la population, mal à l'aise à l'idée de déterrer les fantômes du passé. "A quoi bon", disent les uns, tandis que les autres s'inquiètent des risques pour la cohésion du pays et peut-être aussi pour leur tranquilité personnelle. Pourtant, nulle volonté de revanche dans la démarche des survivants et des enfants de victimes. Simplement la peur de voir leur histoire disparaître avec eux. Car pour ces résistants de l'extrême, l'oubli est la pire des peines.
Le propos du film est justement de montrer les contours flottants de la mémoire collective du pays. Sans voix-off ni commentaire, mais en alternant images d'archives, reportages, témoignages face caméra et même procédés fictionnels (de longs travellings symboliques dans des ruines, ou sur les rayons d'une bibiothèque consacrés à l'Histoire), José-Luis Penafuerte en livre un instantané fuyant, montrant qu'elle emprunte mille chemins différents pour retracer son passé. Par moments, le film tient ainsi de l'enquête policière fascinante où chacun livre "sa" vérité. Comme autant de pièces d'un puzzle, bouleversantes, édifiantes, terribles, cruelles, insupportables. Cet assemblage d'impressions, de souvenirs, de faits et de symboles forme alors le portrait sensible d'une époque et, au-delà de ce pan particulier de l'histoire, livre un message universel, humaniste et plein d'un immense espoir : celui que les horreurs du passé ne se reproduisent plus.
Tags liés à cet article: critique, documentaire, espagne, guerre civile, histoire, José-Luis Penafuerte, les chemins de la mémoire.
Publié dans Critiques, Films |
Posté par MpM, le 17 février 2011
 Entre festivaliers, il se dit qu'une Berlinale sans film évoquant la seconde guerre mondiale ou le nazisme n'est pas vraiment une Berlinale. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans, puisqu'après Les faussaires de Stefan Ruzowitzky, Jud Süß, Film ohne Gewissen d'Oskar Roehler, The good german de Steven Soderbergh, Moi qui ai servi le roi d'Angleterre de Jiri Menzel... les années précédentes, c'est au tour de Mon meilleur ennemi de Wolfgang Murnberger (Autriche) d'être présenté en sélection officielle hors compétition.
Entre festivaliers, il se dit qu'une Berlinale sans film évoquant la seconde guerre mondiale ou le nazisme n'est pas vraiment une Berlinale. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans, puisqu'après Les faussaires de Stefan Ruzowitzky, Jud Süß, Film ohne Gewissen d'Oskar Roehler, The good german de Steven Soderbergh, Moi qui ai servi le roi d'Angleterre de Jiri Menzel... les années précédentes, c'est au tour de Mon meilleur ennemi de Wolfgang Murnberger (Autriche) d'être présenté en sélection officielle hors compétition.
Le film, qui se veut une comédie, raconte l'histoire de deux amis d'enfance séparés par la guerre, puisque l'un est juif et que l'autre s'engage chez les SS. Rien de franchement drôle en apparence puisque le second prend l'avantage sur le premier en lui volant sa maison, sa petite amie et le Michel-Ange qui appartient à sa famille, tandis que le deuxième croupit dans un camp de concentration.
Mais bien sûr, les choses n'en restent pas là et suite à un invraisemblable quiproquo, les rôles sont tout à coup inversés. Le prisonnier endosse avec une certaine satisfaction le rôle du capitaine SS et fait subir à son camarade toutes les humiliations et violences d'ordinaire réservées aux déportés juifs. C'est de loin la meilleure partie du film, ou en tout cas la plus jubilatoire. En cela, c'est une bonne catharsis, à défaut d'être un bon film. Mais passons sur ses grosses ficelles scénaristiques, ses rebondissements prévisibles et son invraisemblance chronique car dans le fond l'enjeu se situe à un autre niveau. Il s'agit de faire rire avec le sujet délicat du nazisme et de la Shoah, et ce sans choquer personne. Une mission autrefois quasi impossible qui peu à peu devient acceptable. Probablement parce que le rire permet de fantasmer sur une réalité où les victimes auraient raison de leur bourreau. Ca tombe bien, cela fait justement partie de la magie du cinéma que de nous donner la possibilité de démythifier et de régler ses comptes avec le passé.
De ce point de vue, les Allemands ont leur lot de traumatismes à évacuer, et c'est sans surprise que  l'on découvre If not us, who (Qui, si ce n'est pas nous ?) d'Andres Veiel, le deuxième film allemand en compétition, qui lui ne s'intéresse pas tant à la deuxième guerre mondiale qu'à ses conséquences et à la naissance de la RAF. On découvre ainsi le contexte et les fondements du mouvement à travers le parcours de Bernward Vesper, fils d'un écrivain nationaliste célébré par les nazis, et de sa compagne Gudrun Ensslin, qui s'engage peu à peu dans le militantisme de gauche, avant de devenir la pasionaria de la lutte armée auprès d'Andreas Baader.
l'on découvre If not us, who (Qui, si ce n'est pas nous ?) d'Andres Veiel, le deuxième film allemand en compétition, qui lui ne s'intéresse pas tant à la deuxième guerre mondiale qu'à ses conséquences et à la naissance de la RAF. On découvre ainsi le contexte et les fondements du mouvement à travers le parcours de Bernward Vesper, fils d'un écrivain nationaliste célébré par les nazis, et de sa compagne Gudrun Ensslin, qui s'engage peu à peu dans le militantisme de gauche, avant de devenir la pasionaria de la lutte armée auprès d'Andreas Baader.
Veiel tente de mettre en lumière les causes diverses de l'émergence de cette contestation organisée qui débouchera sur le terrorisme et la violence. Malheureusement, il se perd aussi en circonvolutions pseudo-romantiques, comme s'il était plus attaché aux aspects sentimentaux de son histoire qu'à son implication politique. De ce fait, il ne peut que survoler superficiellement la réalité de l'époque, terriblement dense et complexe. Reste une passion amoureuse pas banale, mais vidée de sa substance. Pas sûr que ce soit suffisant pour exorciser cette période noire de l'Histoire allemande.
Qu'à cela ne tienne, rendez-vous à la Berlinale 2012 pour découvrir une nouvelle variation sur ce thème... En attendant, on peut toujours revoir La bande à Baader d'Uli Edel, pas beaucoup plus profond d'un point de vue théorique, mais bien plus réussi cinématographiquement parlant.
Tags liés à cet article: allemagne, Berlin, berlin 2011, berlinale, festival, guerre, histoire, politique, seconde guerre mondiale.
Publié dans Berlin, Festivals, Films |
Posté par Morgane, le 12 juin 2010
Vendredi 18 juin, on fêtera les 70 ans de l’appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle. Pour l’occasion, sera projetée en plein air et gratuitement, L’Armée des ombres, adaptation du roman de Joseph Kessel, réalisé par Jean-Pierre Melville (1969). Le film, avec Lino Ventura, Simone Signoret et Paul Meurisse, revient sur les activités et la vie extrêmement difficile d’un réseau de résistants pendant l’occupation allemande.
Le film sera diffusé sur un écran géant installé sur la façade du Centre Pompidou à 23h et sera précédé de courts métrages L’Appel du 18 juin 1940, la voix de la Liberté (22h30).
Tags liés à cet article: Centre pompidou, evenement, histoire, jean pierre melville, l'armee des ombres.
Publié dans Evénements, Films |
Posté par Benjamin, le 28 février 2010
 Du 10 mars au 31 août prochain, le Mémorial de la Shoah propose une exposition intitulée « Filmer les camps ». Une exposition qui se focalisera notamment sur les travaux, sur les images de trois grands cinéastes américains, George Stevens (réalisateur des comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers), Samuel Fuller (réalisateur de polars nerveux et sociétales, en photo) et John Ford qu’il est inutile de présenter. Trois hommes qui ont porté leurs caméras sur les différents théâtres d’opération de la Seconde Guerre mondiale : l’Afrique du Nord, le débarquement de Normandie, la bataille du Midway (où John Ford perdit son œil) et bien entendu, les camps de travail et de concentration (ceux de Dachau et de Falkenau notamment).
Du 10 mars au 31 août prochain, le Mémorial de la Shoah propose une exposition intitulée « Filmer les camps ». Une exposition qui se focalisera notamment sur les travaux, sur les images de trois grands cinéastes américains, George Stevens (réalisateur des comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers), Samuel Fuller (réalisateur de polars nerveux et sociétales, en photo) et John Ford qu’il est inutile de présenter. Trois hommes qui ont porté leurs caméras sur les différents théâtres d’opération de la Seconde Guerre mondiale : l’Afrique du Nord, le débarquement de Normandie, la bataille du Midway (où John Ford perdit son œil) et bien entendu, les camps de travail et de concentration (ceux de Dachau et de Falkenau notamment).
Cette exposition, bien qu’elle porte sur une période de l’Histoire tristement célèbre, est une occasion de s’interroger sur le rôle du cinéma dans l’Histoire et sur l’importance de l’Histoire dans notre société. Un débat, une réflexion qui peut être relancée également avec la sortie prochaine de La rafle, film français avec Jean Reno et Gad Elmaleh qui retrace lesépisodes qui ont conduit des français judaïques du stade du Vel’ d’Hiv’ aux camps de concentration, à l’heure où le débat sur l’identité nationale est au cœur de l’actualité. Un film de fiction qui refait « vivre » un tragique évènement de notre Histoire (l’occasion de confronter – si on le désire - le rôle des fictions et des documentaires lorsqu’il s’agit de toucher à l’Histoire, tout en écartant les films comme 10 000 d’Emmerich qui place les pyramides en 10 000 av. J.C…)
Que peut alors apporter le cinéma à l’Histoire ? Quel pouvoir ont ces images qu’ils nous livrent ? A-t-il un rôle à jouer dans l’Histoire ?
Il ne faut pas perdre de vue que ces images témoignent également d’une évolution majeure. En effet, avec la Seconde Guerre mondiale, ce sont avec les soldats de nombreuses caméras qui débarquent sur les différents lieux du conflit et qui suivent les combats au plus près du danger. Certes, la télévision n’est pas encore là pour reléguer massivement les images aux citoyens comme ce sera le cas avec le Vietnam, mais c’est ici le cinéma qui se pose en acteur du conflit avec des hommes qui risquent leur vie pour capturer des images précieuses. Des images d’autant plus importantes que la Seconde Guerre mondiale est un véritable cap dans l’Histoire de l’humanité où l’horreur a atteint un pic relégué par les témoignages des survivants et des images qui mettent devant le fait accompli les plus sceptiques.
Une exposition, un rendez-vous donc qui semble incontournable au Mémorial de la Shoah parce que ces images (pour la plupart inédites !) témoignent d’un pan unique de notre Histoire. Des films qui maintiennent intact la mémoire qui est certainement notre bien le plus précieux pour avancer…
_______
Site internet et informations sur le Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris
FILMER LES CAMPS, JOHN FORD, SAMUEL FULLER, GEORGE STEVENS
De Hollywood à Nuremberg, exposition du 10 mars au 31 août 2010
Tags liés à cet article: exposition, george stevens, histoire, holocauste, john ford, la rafle, memorial de la shoah, samuel fuller, seconde guerre mondiale, shoah.
Publié dans Evénements, Films, Personnalités, célébrités, stars |
Posté par MpM, le 19 février 2010
 Que serait un festival sans polémique ? Mérité, recherché ou fabriqué de toute pièce, le scandale permet d'entretenir le buzz, de provoquer la curiosité et surtout de faire parler. C'est bon pour l'image comme pour le business, même si la plupart du temps "l'affaire" retombe d'elle-même comme un soufflé en moins de 48h. Que voulez-vous : un film chasse l'autre.
Que serait un festival sans polémique ? Mérité, recherché ou fabriqué de toute pièce, le scandale permet d'entretenir le buzz, de provoquer la curiosité et surtout de faire parler. C'est bon pour l'image comme pour le business, même si la plupart du temps "l'affaire" retombe d'elle-même comme un soufflé en moins de 48h. Que voulez-vous : un film chasse l'autre.
Deux jours avant la remise de l'Ours d'or, et alors qu'il ne reste que trois films en compétition à découvrir, la Berlinale a donc connu sa première mini-polémique 2010, forcément politique. Comme cela arrive souvent ici, la cause en est un film traitant de l'époque nazie. Jud Süss (Film ohne Gewissen) d'Oskar Roehler (Les particules élémentaires) raconte la genèse du film de propagande nazie "Le juif Süss" commandé par Goebbels dans le but de renforcer la haine des Allemands envers le peuple juif. Cette œuvre, qui fut à l'époque montrée à plus de 20 millions de personnes, met en scène un marchand juif censé personnifier la lâcheté, la duplicité et la perversité dans la Prusse du 18e siècle. Elle est aujourd'hui encore interdite en Allemagne.
Le plus grand scandale provient probablement de sa mise en scène outrée et grandiloquente
Ce qui a le plus choqué les journalistes présents à la séance de presse (et qui ont sifflé le film, pratique bien plus rare à Berlin qu'à Cannes), c'est la liberté prise par Oskar Roehler et son scénariste Klaus Richter avec la vérité historique. L'épouse de Ferdinand Marian (l'acteur qui jouait Süss) devient ainsi juive pour les facilités du scénario (plus de compassion, moins de réflexion). Le film oublie aussi de préciser que le comédien continua sa carrière après le succès de Süss, donnant l'impression qu'il n'est qu'une malheureuse victime de Goebbels. Ces "évolutions arbitraires" revendiquées par le réalisateur ôtent à Jud Süss (Film ohne Gewissen) toute caution documentaire, ou au moins historique.
Privé de cela, il ne lui reste plus grand chose tant il est artistiquement raté. Le plus grand scandale provient probablement de sa mise en scène outrée et grandiloquente... mais d'une courte tête seulement devant son scénario si mal ficelé qu'il oublie la moitié des enjeux en route. Ne parlons pas des personnages qui sont au-delà de la caricature, réduits au degré zéro de la psychologie (alcoolique, neurasthénique, fanatique...).
Le sujet, malgré tout, éveille une nouvelle fois la mauvaise conscience et le sentiment de culpabilité des Allemands. D'où la réaction épidermique de certains, et l'ambiance gênée durant la projection. Probablement afin d'éviter tout débordement, la conférence de presse avec l'équipe du film a quant à elle été particulièrement bordée. Le modérateur a très largement monopolisé la parole en interrogeant longuement (et de manière purement inoffensive) les différents intervenants. Ensuite, les autres questions ont surtout porté sur des points de détail concernant les différences entre fiction et réalité.
Pas de quoi lancer une vraie polémique, mais suffisant pour souligner le malaise qui, aujourd'hui encore, accompagne systématiquement toute œuvre touchant au nazisme. Etant Allemand lui-même, Oskar Roehler savait à quoi s'en tenir en choisissant précisément la forme du mélodrame flamboyant et approximatif pour un sujet pareil. De là à penser que les sifflements et la menace de scandale faisaient partie de ses calculs, ou de ceux du Festival de Berlin...
Tags liés à cet article: allemagne, Berlin, berlin 2010, berlinale, festival, histoire, Jud Süss, Oskar Roehler.
Publié dans Actualité, société, Berlin, Festivals |
Posté par vincy, le 17 mai 2009
Le cinéma de Hong Kong a 100 ans cette année. Le premier film, Voler un canard roti, a été réalisé en 1909 par Leung Siu-po et produit par un entrepreneur russo-américain, Benjamin Brodsky. Pour célébrer l'anniversaire, Cannes projette en compétition, Vengeance, de Johnnie To, qui, ironiquement se déroule essentiellement à Macau.
Tags liés à cet article: cannes, cinéma chinois, festival, festival de cannes, histoire, hong kong, johnnie to, nombre d'or, Vengeance.
Publié dans Actualité, société, Cannes, Festivals, Personnalités, célébrités, stars |
Posté par MpM, le 16 décembre 2008
 Un homme marche sans s’arrêter dans la rue, traverse la route, s’engage dans un bâtiment imposant. La caméra le suit, le précède, l’accompagne. Un impressionnant plan séquence de 10 minutes qui nous mène au travers de la Maison du Gouvernement chilien, du sud vers le nord. En chemin, on croise des gardes, une femme dans un bassin rempli d’eau, des chiens errants. En surimpression, une voix-off égraine des bribes de souvenirs, de pensées, de sensations. C’est un choc, à la fois esthétique et émotionnel. Même sans identifier tous les symboles, on sent confusément le poids de l’Histoire qui pèse sur Brises. D’où l’absolue nécessité de rencontrer Enrique Ramirez, son réalisateur, étudiant d’origine chilienne en deuxième année à l’école du Fresnoy (Tourcoing).
Un homme marche sans s’arrêter dans la rue, traverse la route, s’engage dans un bâtiment imposant. La caméra le suit, le précède, l’accompagne. Un impressionnant plan séquence de 10 minutes qui nous mène au travers de la Maison du Gouvernement chilien, du sud vers le nord. En chemin, on croise des gardes, une femme dans un bassin rempli d’eau, des chiens errants. En surimpression, une voix-off égraine des bribes de souvenirs, de pensées, de sensations. C’est un choc, à la fois esthétique et émotionnel. Même sans identifier tous les symboles, on sent confusément le poids de l’Histoire qui pèse sur Brises. D’où l’absolue nécessité de rencontrer Enrique Ramirez, son réalisateur, étudiant d’origine chilienne en deuxième année à l’école du Fresnoy (Tourcoing).
Où avez-vous tourné Brises ?
Enrique Ramirez : J’ai obtenu l’autorisation de tourner dans la Maison du Gouvernement chilien, qui a été détruite pendant le coup d’état de Pinochet puis reconstruite. Cela m’a pris un an d’avoir cette autorisation… et je l’ai eue seulement la veille du tournage. Cet endroit se visite mais seulement dans un sens : du nord vers le sud, c’est-à-dire de <la Place de la Constitution vers la Place de la Citoyenneté. Moi, je voulais aller dans l’autre sens, commencer par le côté interdit.
Pourquoi ?
E.R. : Je trouve ça incroyable que l’on soit en démocratie, que les portes soient ouvertes au public… mais que malgré tout on ne puisse pas choisir le sens de la visite, ou revenir en arrière dans le bâtiment. C’est symbolique du fait qu’au Chili, on essaye d’oublier l’Histoire. Or c’est important pour construire une nouvelle histoire de ne pas oublier le passé ! D’où l’idée de traverser la Maison du Gouvernement qui est un lieu symbolique pour tous les Chiliens. Elle évoque à la fois la guerre civile, la mort d’Allende et le retour à la Démocratie. La traverser, c’est comme traverser l’Histoire. C’est aussi pour cela que l’eau est un élément important dans le film : l’eau nettoie, mais la seule chose que l’on ne peut pas nettoyer, c’est la mémoire.
Vous ne donnez dans le film ni explications sur la signification du lieu ni rappels historiques…
E.R. : J’ai voulu faire le film pour les Chiliens mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire, que cela fonctionne pour les deux grâce à un travail sur l’imaginaire et les sensations. Et puis la guerre, l’histoire, la mémoire, les gens qui disparaissent… tous les pays connaissent cela ! J’ai voulu donner cette portée universelle au film, d’où l’absence d’explication. Le texte est plutôt autobiographique, il évoque des images de l’enfance qui peuvent parler à tout le monde. Moi, j’ai grandi avec la dictature et ça me paraissait un peu normal car je n’avais rien connu d’autres ! Ce n’est que des années après que j’ai compris ce qui s’était réellement passé.
Comment s’est concrètement passé le tournage ?
E.R. : Nous avions l’autorisation de tourner une matinée. Je n’étais pas sûr que nous aurions le temps de faire deux prises… mais finalement ça a été possible, et c’est la seconde qui est dans le film. Comme le palais est dans la rue principale de Santiago, il n’était pas possible d’arrêter le trafic. Mais j’aime bien travailler comme ça, avec les passants qui font partie du film. J’aime bien le hasard… le fait de ne pas tout contrôler. C’est pour cela que j’aime les plans-séquences.
________________________
A voir : le palmarès complet des Rencontres internationales Henri Langlois.
A noter : Brises sera diffusé le 27 décembre à 20h dans le cadre de la manifestation Dans la nuit les images au Grand Palais à Paris.
Tags liés à cet article: brises, chili, Courts métrages, enrique ramirez, festival, films d'école, histoire, le fresnoy, palmarès, Poitiers, Prix, rencontres henri langlois, rihl.
Publié dans Courts métrages, Festivals, Poitiers |
Posté par vincy, le 23 novembre 2008
 Pour ses cinquante ans, le cinéma marocain a profité du Festival international du film de Marrakech (FIFM) pour établir son bilan. Cetes le Festival, à l'origine destiné pour défendre le cinéma africain et arabe, est devenu un instrument marketing pour la ville de Marrakech et le Royaume du Maroc. Une vitrine luxueuse (et coûteuse) où l'on invite médias français et stars hollywoodiennes.
Pour ses cinquante ans, le cinéma marocain a profité du Festival international du film de Marrakech (FIFM) pour établir son bilan. Cetes le Festival, à l'origine destiné pour défendre le cinéma africain et arabe, est devenu un instrument marketing pour la ville de Marrakech et le Royaume du Maroc. Une vitrine luxueuse (et coûteuse) où l'on invite médias français et stars hollywoodiennes.
Pourtant, Marrakech mériterait de promouvoir davantage le cinéma maghrébin et d'attirer l'aspect industriel de la profession. Car le Maroc manque de salles. Au point que les quotidiens nationaux peuvent aficher la programmation des quelques multiplexes sur une demi page (Megarama est présent à Casablanca et Marrakech). Les sorties sont presque simultanées avec l'Europe, et les films américains se taillent la part du lion d'un marché qui se réduit année après année. Les Marocains préfèrent regarder la télévision. Il y a trente ans, 40 millions de spectateurs allaient dans les salles chaque année, il n'en reste plus que quatre millions. La faute aux chaînes étrangères et aux antennes satellites. Pendant le Ramada, la prgrammation cinéma est si intense que tous les blockbusters hollywoodiens remplissent les écrans.
Peu de nouvelles salles se son construites, beaucoup ont disparu, et la vétusté de la plupart des cinémas n'incite pas à séduire un public en voie d'occidentalisation. Le Maroc ne compte que 90 écrans (130 de moins en trente ans), soint trois fois moins qu'en Afrique du Sud ou en Egypte. Il y aurait un manque de 150 salles.
Une association "Sauvons les salles de cinéma au Maroc" est née il y a un an (voit leur site : savecinemainmarocco.com), dans ce même Festival du film de Marrakech. L'associationveut que le cinéma redevienne un vecteur régional de culture et d'ouverture, tout en sensibilisant les citoyens sur l'état désastreux de l'exploitation cinématographique locale. L'Eden de Marrakech, avec le soutien de l'Unesco, sera le premier chantier de réhabilitation lancé par l'association.
Hélas, depuis un an, une salle (à El Jadida) à été complètement détruite, après cinq ans de fermeture, et quatre ont baissé le rideau (deux à Fès, une à Al-Hoceima, une autre à Casablanca).
Le cinéaste Ahmed El Maânouni évoquait en avril dernier au quotidien L'Humanité ce problème de chaînon manquant pour favoriser la croissance d'un cinéma nord-africain. "Il y a (...) le problème du piratage. On peut acheter Bienvenue chez les Ch’tis pour un euro. Il y a deux multiplexes au Maroc dont un tenu par un Français, Claude Lemoine, à Casablanca. Le second est à Marrakech. Il me semble que ceux qui analysent mal la situation disent que le cinéma ne se porte pas bien à cause des multiplexes. Or, il en faudrait beaucoup plus car cela permet une offre de films variée avec un accueil marchand qui fait venir le client. Nous en sommes réduits à ça. On a besoin des petites salles de quartiers et de multiplexes."
Tags liés à cet article: ahmed el maanouni, bienvenue chez les ch'tis, Box office, casablanca, cinéma marocain, festival international du film de marrakech, histoire, l'humanité, maroc, marrakech, multiplexes, piratage, politique, salles de cinéma.
Publié dans Business, Festivals, exploitation, salles de cinéma |
Posté par MpM, le 9 octobre 2008
 Pas de festival de films sans un grand classique du genre : la fresque historique directement inspirée d’éléments réels. Puisqu’à Toulouse, il s’agit de cinéma espagnol, la guerre civile opposant Républicains et Franquistes entre 1936 et 1939 semble un passage obligé. Près de soixante-dix ans après les faits, cet épisode brûlant de l’Histoire espagnole continue en effet à hanter bien des films, que ce soit anecdotique (un ancien républicain réfugié en Uruguay et confronté au coup d’état de 1973 dans Paisito d’Ana Diez), ou plus structurel (le héros de El hombre de arena de José Manuel Gonzalez-Berbel qui, pour avoir tenté d’obtenir justice pour ses parents assassinés par un phalangiste, est jeté en prison). Dans tous les cas, on sent le sujet douloureux, et pas vraiment apaisé.
Pas de festival de films sans un grand classique du genre : la fresque historique directement inspirée d’éléments réels. Puisqu’à Toulouse, il s’agit de cinéma espagnol, la guerre civile opposant Républicains et Franquistes entre 1936 et 1939 semble un passage obligé. Près de soixante-dix ans après les faits, cet épisode brûlant de l’Histoire espagnole continue en effet à hanter bien des films, que ce soit anecdotique (un ancien républicain réfugié en Uruguay et confronté au coup d’état de 1973 dans Paisito d’Ana Diez), ou plus structurel (le héros de El hombre de arena de José Manuel Gonzalez-Berbel qui, pour avoir tenté d’obtenir justice pour ses parents assassinés par un phalangiste, est jeté en prison). Dans tous les cas, on sent le sujet douloureux, et pas vraiment apaisé.
Un peu à part, Las 13 rosas d’Emilio Martinez-Lazaro se déroule dans l’immédiate après-guerre, en avril 1939, lorsque les troupes triomphantes de Franco entrent dans Madrid. Basé sur des événements réels, il raconte le démantèlement puis l’élimination d’un réseau de partisans en grande partie constitué de jeunes filles mineures dont le seul crime est d’avoir distribué des tracts réclamant "moins de Franco, plus de pain". Le principal intérêt du film est le portrait très juste qu’il brosse de cette période troublée où la peur, la lâcheté, l’instinct de survie et la bêtise l’emportent sur l’humanité. Ce sont de vieilles femmes affolées qui dénoncent n’importe qui, des anciens combattants terrifiés prêts à trahir leurs amis pour sauver leur peau, des policiers zélés à qui le pouvoir monte à la tête, des franquistes sincères embarqués dans une chasse aux sorcières qui les dépasse… Et face à eux, non pas des héros, non pas des guerriers féroces, mais simplement une poignée de jeunes femmes à l’insouciance presqu’inconsciente, juste mues par une cause qu’elles croient juste.
Même si Emilio Martinez-Lazaro ne fait pas forcément dans la nuance, ne nous épargnant notamment ni la violence des diverses méthodes musclées d’interrogatoire, ni le pathos d’une fin inutilement mélodramatique, qui plus est filmée sans subtilité ni retenue, là n’est pas l’essentiel. Ce qui frappe, c’est la résonance universelle de son film, qui pourrait se dérouler dans l’Allemagne nazie comme dans la France de la collaboration, ou dans n’importe quel pays autoritaire où une partie de la population fait la chasse à une autre. Immanquablement, on pense à Sophie Scholl les derniers jours de Marc Rothemund qui met en scène, quoiqu’ avec plus de maîtrise et de rigueur, une autre jeune fille naïve faisant trembler la lourde machine de la police politique, et qui le paye de sa vie dans un simulacre de procès. Les dirigeants et les causes changent, les méthodes de répression restent les mêmes, nous met en garde le réalisateur. Comme un appel à la vigilance ? En tout cas, dans la salle de Cinespana, quand les lumières se rallument, quelques voix reprennent en chœur "viva la Republica" au milieu des applaudissements.
Tags liés à cet article: ana diez, cinéma espagnol, Cinespana, El hombre de arena, Emilio Martinez-Lazaro, espagne, festival, franco, guerre, guerre civile, histoire, José Manuel Gonzalez-Berbel, las 13 rosas, paisito, toulouse.
Publié dans Cinespana, Critiques, Festivals, Films |
Posté par vincy, le 11 septembre 2008
 En septembre 1938, les accords de Munich, souvent considérés comme le début de la seconde guerre mondiale et comme un acte de trahison des grands pays vis-à-vis de la Tchécoslovaquie, a livré Prague aux Nazis.
En septembre 1938, les accords de Munich, souvent considérés comme le début de la seconde guerre mondiale et comme un acte de trahison des grands pays vis-à-vis de la Tchécoslovaquie, a livré Prague aux Nazis.
Milos Forman, le cinéaste tchèque le plus connu et le plus récompensé au monde, a accepté de mettre en scène le scénario de Vaclav Havel.
L'ancien président de la République Tchèque, par ailleurs dramaturge, a décidé d'écrire l'adaptation cinématographique du livre de Georges-Marc Benamou (l'ex-collaborateur "culture" de Nicolas Sarkozy et le capricieux de la Villa Médicis), Le fantôme de Munich. Havel a déjà préfacé l'edition locale qui sera publiée à l'occasion des 70 ans de la signature de ces accords.
Tags liés à cet article: adaptation litteraire, cinéma tcheque, georges marc benhamou, histoire, milos forman, nazi, prague, projet, république tcheque, seconde guerre mondiale, vaclav havel.
Publié dans Actualité, société, Projet, tournage |
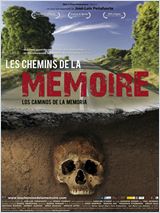 "Nier l'Histoire, c'est risquer de la répéter."
"Nier l'Histoire, c'est risquer de la répéter."













 Flux rss
Flux rss

