 Sundance, clap de fin. Les films récompensés vont maintenant faire le tour du monde et des festivals : Cannes (Un certain regard, Quinzaine des réalisateurs...), Tribeca, Venise, Deauville, Locarno, Toronto...
Sundance, clap de fin. Les films récompensés vont maintenant faire le tour du monde et des festivals : Cannes (Un certain regard, Quinzaine des réalisateurs...), Tribeca, Venise, Deauville, Locarno, Toronto...
Cette année, seuls deux films gagnent plus d'un prix et aucun ne parvient à réconcilier jury et public, qui ont chacun fait des choix différents. A l'étranger, le cinéma sud américain se taille la part du lion.
Les droits de Winter's Bone (Grand prix du jury fiction et meilleur scénario) ont été acquis lors du Festival pour être distribué aux Etats-Unis par Roadside Entertainment. A noter que les plus gros chèques des studios ont été faits pour des films absents du palmarès.
Prix du jury :
Grand prix du jury - documentaire : Restrepo, de Sebastian Junger et Tim Hetherington. Plongée d'une rare violence dans l'enfer de la guerre, à travers la vie quotidienne d'un peloton de 15 soldats américains postés dans l'une des régions les plus dangereuses d'Afghanistan.
Grand prix du jury - fiction : Winter’s Bone, de Debra Granik. Portrait d'une adolescente qui traverse la région sauvage des montagnes d'Ozark, au coeur des Etats-Unis, pour retrouver son père, trafiquant de drogue.
Prix cinéma du monde - documentaire : The Red Chapel (Det Røde Kapel), de Mads Bru?gger - Danemark. Un groupe de journalistes se fait passer une troupe de théâtre pour infiltrer le régime nord-coréen.
Prix cinéma du monde - fiction : Animal Kingdom, de David Micho?d - Australie. Les pas d'un adolescent aux prises avec une famille de truands à Melbourne.
Meilleur réalisateur - documentaire : Leon Gast (Smash his Camera)
Meilleur réalisateur - fiction : Eric Mendelsohn (3 Backyards)
Meilleur réalisateur étranger - documentaire : Christian Fei - Suisse (Space Tourists)
Meilleur réalisateur étranger - fiction : Juan Carlos Valdivia - Bolivie (Southern District)
Meilleur scénario : Winter’s Bone, de Debra Granik et Anne Rosellini
Meilleur scénario étranger : Southern District, de Juan Carlos Valdivia - Bolivie
Meilleur montage - documentaire : Joan Rivers—A Piece Of Work, monté par Penelope Falk
Meilleur montage - documentaire du monde : A Film Unfinished, monté par Joe?lle Alexis - Allemagne/Israël
Meilleure photographie - documentaire : The Oath, image de Kirsten Johnson et Laura Poitras.
Meilleure photographie - fiction : Obselidia, image de Zak Mulligan.
Meilleure photographie - documentaire du monde : His & Hers, image de Kate McCullough et Michael Lavelle - Irlande
Meilleure photographie - fiction du monde : El Hombre de al Lado (The Man Next Door), image de Mariano Cohn et Gasto?n Duprat - Argentine
Prix spécial du jury cinéma du monde - meilleure interprétataion : Tatiana Maslany (Grown Up Movie Star) - Canada
Prix spécial du jury cinéma du monde - documentaire : Enemies of the People, de Rob Lemkin et Thet Sambath - Cambodge / Royaume
Prix spécial du jury - documentaire : Gasland , de Josh Fox
Prix spécial du jury - fiction : Sympathy for Delicious, de Mark Ruffalo
Prix du public :
- documentaire : Waiting for Superman, de Davis Guggenheim
- fiction : happythankyoumoreplease, de Josh Radnor
- documentaire du monde : Wasteland, de Lucy Walker - Royaume Uni/Brésil
- fiction du monde : Contracorriente (Undertow), de Javier Fuentes-Leo?n - Pérou
Prix Best of NEXT : Homewrecker, de Todd & Brad Barnes
Prix Albert P. Sloan - meilleur film mettant en valeur les Sciences et Technologies : Obselidia, de Diane Bell
Gagnants du Prix des cinéastes intrenationaux du Sundance Institute & de NHK : Amat Escalante (Mexique) ; Andrey Zvyagintsev (Russie) ; Daisuke Yamaoka (Japon) ; Benh Zeitlin (USA)





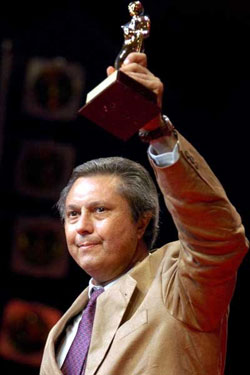



 Pour éviter tous malentendus, pour mettre les points sur les "i" avant de clamer toute chose, il faut préciser sans tarder que tous les films de la compétition n’ont pas été vus et que donc cet article ne concerne qu’un petit nombre d'entre eux.
Pour éviter tous malentendus, pour mettre les points sur les "i" avant de clamer toute chose, il faut préciser sans tarder que tous les films de la compétition n’ont pas été vus et que donc cet article ne concerne qu’un petit nombre d'entre eux.

 Flux rss
Flux rss

