La Berlinale, que l'on a connue moins frileuse concernant le cinéma d'animation (ours d'or ex-aequo pour Le voyage de Chihiro de Miyazaki en 2002, prix de mise en scène pour l'Ile aux chiens de Wes Anderson en 2018, sélection officielle pour Have a nice day de Liu Jian en 2017), présente hors compétition le nouveau film de Pixar, En avant de Dan Scalon, qui sortira en France le 4 mars prochain.
Au risque de décevoir les fans du studio, disons d'emblée que ce n'est pas une excellente cuvée. Certes, une fois revenus du choc d'un design personnages plutôt moche, on se laisse emporter par les aventures de ces deux frères elfes qui, ayant très peu connu leur père décédé (et même pas du tout pour l'un d'entre eux), ont enfin la chance de passer une journée avec lui. On n'a guère le choix, de toute façon, tant le film, tonitruant et presque hystérique, nous abreuve en continu d'un flot d'action, de rebondissements et de péripéties.
Un réflexe pavlovien fait que l'on adhère à une partie du récit, malgré le prétexte microscopique de départ (le père magicien a laissé des instructions plus qu'incomplètes pour sa résurrection temporaire, lançant ses fils - quelle surprise - dans une quête frénétique), parce que le mélange conte initiatique, univers magique et double dose d'émotion est un cocktail savamment maitrisé par les scénaristes. Il faut d'ailleurs être honnête : on est effectivement ému à plusieurs reprises par cette histoire extrêmement familiale, et surtout par la relation qui unit les deux frères, dont l'ainé s'avère le vrai personnage principal, bien plus intéressant que le cadet complexé-froussard-et-timide-qui-finit-par-se-révéler-en-cours-de-film déjà vu cent fois.
Il est peut-être symptomatique, néanmoins, que ce soit ce dernier qui soit présenté comme le héros et narrateur de l'intrigue, au lieu de Barley, le rêveur passionné par le passé, la magie et tout ce qui réenchante le monde. Comme si, symboliquement, Ian représentait la sécurité d’une histoire proprette qui rassemble, alors que Barley représentait le risque (très mesuré, on vous rassure) de sortir un peu des sentiers battus en allant à fond dans les codes du jeu de rôle et de l'heroic fantasy, ici brossés à grands traits stéréotypés et souvent narquois.
Ce film-là nous aurait surpris, déstabilisés peut-être, et surtout nous aurait contraints, sans obligation de résultats, à le suivre en terrain inconnu, non balisé, entièrement sien. Mais sans doute cela n'aurait pas été assez à l'image de ce que Pixar semble désormais chercher à faire, du divertissement mainstream qui n’en finit plus d’appliquer les mêmes recettes. Les touches de fantaisie sont donc savamment contrôlées, presque cosmétiques, au service d'une histoire qui ronronne : la quête est nécessairement intime (permettant au personnage de réaliser des choses sur lui-même), son issue compte moins que le voyage accompli, les blessures du passé seront refermées, et tout le monde sera joyeusement réconcilié à la fin. Pas une étape qui ne soit "obligée", dictée par on ne sait quel guide en scénario pour film familial à haut potentiel de box-office.
Si Pixar n'avait pas réussi par le passé à nous faire étrangement vibrer avec des histoires novatrices, souvent audacieuses, brillamment écrites, probablement qu’on ne lui en voudrait pas autant de ne plus chercher à nous étonner et à nous emporter. Mais en l'état, c'est comme si le studio nous servait de la bonne cuisine standardisée après nous avoir régalée de petits plats maison créés rien que pour nous. Est-ce vraiment là le cinéma familial que l'on souhaite, reposant sur l'éternel même équilibre entre émotion et comédie, action et introspection ? Où est la poésie de Wall-E ? Qu'est-il advenu du grain de folie de Ratatouille et de l'ironie de Là-Haut ?
Et à quand un nouveau souffle dans le cinéma d'animation grand public issu des studios, à commencer par des designs moins formatés, des formes plus singulières, et des histoires renouvelées, c'est-à-dire qui s'affranchissent de la nécessité d'être toujours édifiantes, initiatiques ou pédagogiques, ou qui au contraire tentent de regarder le monde en face ? Hormis le deuil, qui est bien souvent résolu par le cheminement du personnage principal, on aimerait voir plus souvent des thèmes graves ou sensibles, des questions contemporaines et des enjeux concrets de société traités par les blockbusters animés hollywoodiens. Après tout, les rares incursions dans le domaine ont jusque-là plutôt été des succès : Pixar et les autres devraient avoir une plus grande confiance dans leur propre talent.








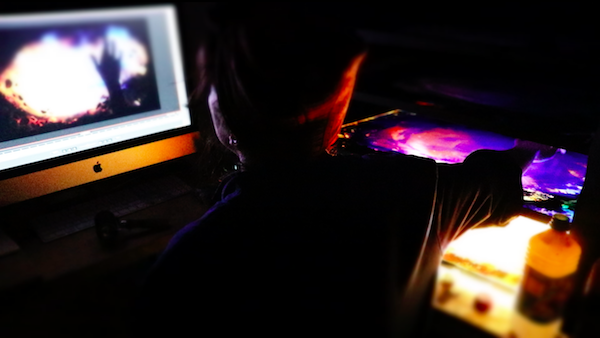

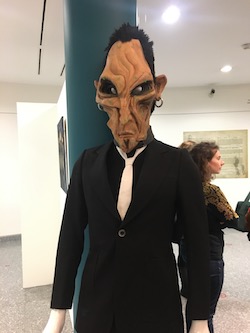























 Flux rss
Flux rss

